On ne va pas se mentir, pour la plupart des gens qui connaissent le studio, Drinkbox c’est Guacamelee, ce metroidvania cartoon et coloré à ambiance Mexique et mariachis, dans lequel on distribuait des suplex à des squelettes entre deux transformations en poulet. Devenu plutôt culte dans le milieu indé, le titre a pas mal éclipsé le reste de la production du studio, du sympathique Severed (qui a eu la malchance d’être une exclu PS Vita, avant de finalement sortir sur iOS et diverses consoles Nintendo) au vieillot Tales from Space: Mutant Blobs Attack, en passant par le dernier en date : le malheureusement oubliable Guacamelee 2, qui ne proposait finalement qu’une version 1.5 de son prédécesseur et tirait inutilement sur la corde d’une formule certes efficace, mais pas au point d’en faire une franchise. Trois ans et demi après cet accueil mitigé, le studio revient avec un titre (en apparence) fondamentalement différent de ses grands frères : Nobody Saves the World, un hack’n’slash post-apocalyptique.
Et si la forme s’éloigne effectivement des Guacamelee et Severed, les quelques gimmicks de Drinkbox, leur patte même, sont toujours bien là, pour le meilleur, cette fois. Car oui, disons-le tout de suite, ce Nobody Saves the World est ma première très bonne surprise de l’année, au point qu’il m’aura été difficile d’en décrocher jusqu’à la fin, et que je me tâte à poursuivre ce new game + fraîchement démarré, juste histoire d’avoir une nouvelle dose.
Du neuf avec du vieux
Des gimmicks, donc, disais-je. Au premier abord, le lien ne se fait pas des masses, entre le metroidvania en 2D, le jeu de sabre à la première personne et le hack’n’slash à la multitude de personnages, et j’avoue avoir été trompé le premier. Mais sous une forme fluctuante d’un opus à un autre, la formule Drinkbox reste bien là, et plus solide que jamais. Si l’épisode Guacamelee 2 semblait vouloir faire mieux en ne faisant que plus, Nobody Saves the World est la somme de toutes les obsessions de Drinkbox, qui n’auraient conservé que les forces de leurs jeux précédents, pour les condenser dans leur petit dernier.
Ainsi, on retrouve ce très chouette système de boucliers cher au studio. Drinkbox le développe depuis Guacamelee et Severed : pour briser la protection d’un ennemi entouré de rouge, il faut une attaque rouge, pour une protection bleue, il faut du bleu, etc., je ne vais pas vous faire tout l’arc-en-ciel. Dans les deux cités, il s’agissait d’attaques orientées : l’attaque spéciale vers le haut correspondait à une certaine couleur, celles vers le bas, en diagonale ou droit devant en avaient une autre : simple, instinctif et propice à des enchaînements assez techniques pour des combats plutôt exigeants. Il est d’ailleurs assez intéressant de comparer cette mécanique avec celle des forces et faiblesses que l’on peut retrouver dans des RPG au tour par tour comme Pokémon et les titres de Moonana (Virgo Vs the Zodiac, Osteoblasts, Keylocker), basée sur un système de pierre/feuille/ciseaux. Si ces deux mécaniques sont finalement assez similaires (choisir la bonne attaque pour briser une protection), on comprend aisément pourquoi le choix d’une association de couleurs se fait pour un titre d’action nerveuse, quand un combat au tour par tour permet de réfléchir à quelle couleur ou élément sera efficace contre l’autre.

Dans Nobody Saves the World, le système reste le même : les attaques vertes pour briser les protections vertes, les oranges pour les oranges et les cochons sont bien gardés. Le hack’n’slash impliquant cependant une certaine approche tactique et personnalisation, la mécanique se trouve un peu développée, dans le sens où ce sera au joueur de choisir quel type d’attaques et d’effets seront attribués à son personnage et de l’adapter tout au long du jeu et des situations, pour un rendu certes bien moins technique et nerveux, mais finalement très intéressant dans son aspect planification.
Le reste de la patte Drinkbox se remarque bien plus facilement : l’univers est toujours aussi coloré et cartoonesque et l’humour est toujours aussi absurde et référencé – cependant bien mieux dosé que dans Guacamelee, qui, bien qu’assez drôle, finissait parfois par être lourdingue ou indigeste à force de vouloir citer toute la pop culture du monde – et la structure reste assez similaire, avec son petit monde ouvert, dont les zones et les multiples secrets se dévoilent au fur et à mesure des capacités débloquées. À bien des égards, Nobody Saves the World m’a fait réaliser à quel point Drinkbox était proche de The Behemoths (Castle Crashers, Battleblock Theater, Pit People), avec son catalogue aux gameplays variés, mais à l’esthétique et aux gimmicks constants et cohérents d’un titre à l’autre. Mince, même cette incroyable bande-son electro-déb signée par Jim Guthrie – qui abandonne l’ambiant glaçant pour faire du poumpoum bien efficace et entraînant – s’inscrit dans la lignée des OST du studio – et n’aurait pas non plus été déplacée dans un Pit People.

Drinkbox met les formes
C’est bien beau de conserver les traditions et de rester dans sa ligne éditoriale, mais si le titre de Drinkbox tabasse autant, c’est aussi car il innove et part sur une base de gameplay toute fraîche. On démarre Nobody Saves the World avec un personnage tout blanc et tout vide de souvenirs et de personnalité. Très vite, on comprend que Nostramagus, la superstar des magiciens, a disparu, et qu’en son absence, une terrible créature nommée La Calamité est en train de mettre le boxon et de corrompre hommes, femmes, villages et animaux. Notre Nobody va hériter presque par accident de la baguette du mage disparu, baguette qui lui donnera le pouvoir de se transformer en environ tout et n’importe quoi. Et c’est là que ça devient assez génial.
Pour nous introduire au concept, le titre commence par nous donner la forme du rat. Grâce à sa taille, il peut se faufiler dans les espaces les plus étroits – tiens, comme le poulet de Guacamelee – mais aussi empoisonner les ennemis avec ses attaques au corps à corps. Et là il va falloir que je reste clair pour ne pas vous perdre, car si le système de progression est on ne peut plus instinctif quand on est dedans, il peut être un peu délicat à expliquer. Car à partir de ce moment, tout se divise en deux. Notre personnage possède une barre d’expérience, qui se remplit en accomplissant les quêtes principales et secondaires de l’histoire, barre d’expérience permettant de monter de niveau et d’augmenter une base de stats (attaque, défense, vitesse, c’est très classique), commune à toutes les formes que vous pourrez prendre. D’un autre côté, chaque forme – donc pour l’instant le rat, mais par la suite il y aura un chevalier, un robot, un zombie, un dragon, une sirène et une pelletée d’autres trucs – aura ses propres quêtes, qu’il ne sera possible d’accomplir que sous cette forme et qui permettra d’augmenter sa propre barre d’XP, qui débloquera des compétences actives et passives et, à terme, de nouvelles formes.

Vous suivez ? J’espère, car ce n’est pas fini. Si ce système est assez cool sur les premières heures et permet d’alterner facilement entre le rat, le chevalier et l’archère, on se dit que le fun ne va pas durer, et qu’avec 4 compétences par personnage, on va finir par tourner en rond bientôt. Ça n’arrive pas, car assez vite, la baguette se voit améliorée, et permet d’assigner à chaque forme les compétences des autres, et de modeler chaque personnage à son envie, en tenant compte des combinaisons possibles et pertinentes pour chaque forme. On se retrouve de ce fait face à une merveille de conception et de courbe de progression, où chaque action, chaque combat, chaque donjon, chaque quête fait monter des jauges, débloque des pouvoirs et des personnages jouables, qui augmenteront à leur tour la quantité de builds possibles, pourtant déjà énorme. Jusqu’à la fin du jeu – comptez une grosse vingtaine d’heures -, j’ai continué de découvrir de nouvelles compétences et de remodeler, parfois depuis le début, les combinaisons de pouvoirs de mes personnages. Et je suis assez conscient de ne pas tous les avoir exploités à fond, la diversité de personnages et d’attaques permettant de plier le gameplay à son style de jeu et ses affinités, sans avoir à se bloquer dans une classe ou un choix de personnage.
Donjons et donjons. Et donjons.
C’est malheureusement aussi là que se trouve la limite de Nobody Saves the World. En se posant comme un immense et génial terrain d’expérimentation de pouvoirs et personnages, il finit par régulièrement faire passer son univers et son scénario au second plan, et nous conduit à massacrer des centaines et des centaines de monstres plus pour remplir des jauges et encore d’autres jauges que pour réellement faire progresser l’histoire. Comme, eh bien, beaucoup de hack’n’slash, finalement. Et si l’amusement ne disparaît jamais complètement – l’apparition d’une nouvelle forme est toujours très satisfaisante, et relance systématiquement l’intérêt du jeu pour les heures à venir -, on se retrouve tout de même un peu trop souvent sur le dernier tiers de jeu à buter des monstres de manière un peu vaine, dans le simple but de remplir cette ultime jauge qui débloquera la compétence ou la nouvelle forme souhaitée. Un peu dommage, mais rien qui ferait oublier la solidité du système de progression et de combat, ni l’inventivité des formes et de leurs compétences.
Et heureusement que cet aspect est si réussi, car une bonne partie du titre se déroule dans des donjons générés de manière procédurale – et dont l’architecture changera à chaque nouvelle tentative. Des donjons au level design forcément assez pauvre, voire inintéressant, et avec parfois quelques petites injustices dans le placement des ennemis. Il m’est arrivé à quelques reprises de mourir bêtement car les monstres étaient placés de manière à me coincer dans un cul-de-sac, et que je ne pouvais ni m’en débarrasser ni les fuir. Assez frustrant, d’autant plus quand on sait qu’un donjon perdu implique de le recommencer depuis le début, avec une nouvelle architecture générée – pour rester dans la tradition du studio, Nobody Saves the World est franchement corsé, avec même quelques passages que l’on pourrait qualifier d’impitoyables. Encore une fois, rien qui ne pourrait m’empêcher de le recommander, d’autant que cet aspect procédural reste cohérent avec cette philosophie de farm et d’expérimentation – j’ai refait avec plaisir certains donjons pour tester de nouvelles builds -, mais qui ajoute encore une pierre au sentiment de vacuité qui peut parfois poindre son nez sur la dernière partie du jeu.

Nobody Saves the World a été testé sur PC via une clé fournie par l’éditeur. Il est également disponible sur consoles Xbox.
S’il est perfectible sur le level design de ses nombreux donjons et l’aspect parfois vain – et terriblement addictif – de ses innombrables jauges, Nobody Saves the World n’en reste pas moins une indéniable réussite. Son système de formes et de compétences partagées est une excellente idée, propice à une quantité démentielle de builds possibles et d’expérimentations en tout genre. Cette mécanique brillante en fait un titre particulièrement généreux et amusant – un genre d’amusement très régressif consistant à trouver les moyens les plus efficaces ou inattendus d’étriper des monstres, certes -, particulièrement bien servi par une esthétique cartoon et colorée, un humour bien dosé et une bande-son décapante. Un retour en forme pour Drinkbox.

Shift
Camélidé croisé touche de clavier et militant pro-MS Paint. J'aime les jeux indés à gros pixels, les platformers sadiques et les énigmes.
follow me :

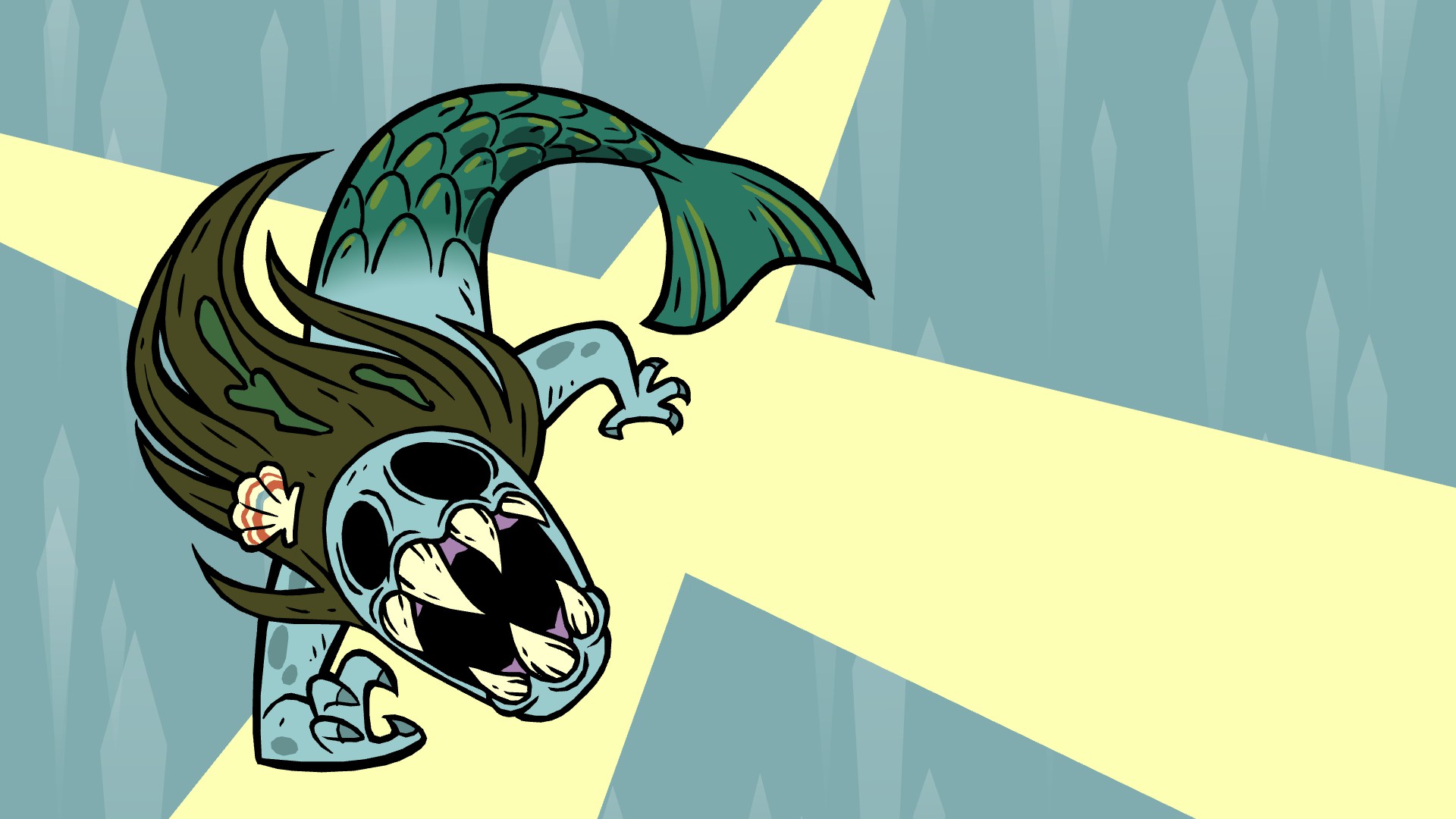

Articles similaires
River Towns - Casse-tête fluvial
avr. 02, 2025
Sultan's Game - Prêt atout pour survivre
avr. 02, 2025
Atomfall - Sandwich à l'Atome de Savoirs
avr. 01, 2025