Avec cet entretien, nous voulions pouvoir ouvrir un espace de discussion – et de lecture, si possible – libéré des contraintes de temps, du renouvellement constant de l’actualité et des discours promotionnels, en remettant en avant l’échange avec des professionnels qui travaillent sur et autour du jeu vidéo. En pleine expansion, nouvel eldorado de l’industrie culturelle et source de débats continuellement renouvelés, ce dernier trouve son prolongement dans une multitude de thématiques pouvant, au premier regard, paraître étrangères à l’idée qu’on se fait du jeu vidéo mais qui, pourtant, participent à en faire un média passionnant. Ce sont ces interactions, ces échanges que nous tentons ici de creuser, en espérant proposer un ensemble riche et cohérent autant qu’agréable à lire, en gardant à l’esprit notre objectif premier : faire vivre la parole d’un individu dans sa singularité. Aujourd’hui, rencontre avec Alexis Blanchet. Bonne lecture !
Entretien réalisé en février 2019
Alexis Blanchet est un des premiers enseignants-chercheurs français à avoir fait du jeu vidéo son sujet d’étude. Maître de conférences à l’université, ses cours portent sur le cinéma, le jeu vidéo et, dans la continuité de son travail de thèse, les liens qui se tissent entre les deux médias. Directeur du diplôme de master à la Sorbonne Nouvelle jusqu’en décembre 2018, il s’est ouvertement montré en défaveur de la loi ORE avant de se mettre en grève à la suite de l’intervention des forces de l’ordre pour déloger les étudiants occupant le campus de Censier le 30 avril 2018. Avec nous, il revient dans un premier temps sur ces événements et cet engagement, indissociable de son parcours, sur lequel nous nous attardons ensuite. Attentif aux évolutions de l’industrie, il dresse un état des lieux des problématiques qui la nourrissent actuellement, ainsi que celles de la recherche sur le jeu vidéo, évoluant nécessairement en parallèle de son objet d’étude. Avant de conclure sur l’axe emprunté dans son prochain ouvrage, dédié à l’histoire du jeu vidéo français, et les pistes qui semblent dessiner le futur de son parcours de chercheur.
Sommaire
– Partie 1 : « J’arrête parce qu’on crève de ne pas arrêter » – Partie 2 : « Chercheur de banlieue »
– Partie 3 : « Le modèle du AAA a vécu ses meilleures années » – Partie 4 : « Qu’est-ce qu’on fait du jeu vidéo ? »
Partie 1 : « J’arrête parce qu’on crève de ne pas arrêter »
Comment définiriez-vous les activités que vous exercez actuellement ?
Je suis enseignant-chercheur donc une partie de mon temps est consacrée à l’enseignement dans le département de cinéma et d’audiovisuel de l’université Paris 3 que j’ai intégrée il y a 8 ans. Je donne plusieurs cours sur le jeu vidéo avec des approches variées ainsi que des cours plus classiques d’histoire du cinéma ou d’analyse de genres cinématographiques. Et puis j’ai également des activités de recherche et d’écriture. Ca, c’est sur le papier. De l’autre côté, j’ai des investissements en qualité d’élu de la Sorbonne Nouvelle, ce qui me permet de siéger à la CFVU (Commission de la formation et de la vie universitaire) ainsi qu’au conseil académique où je participe à la prise de décisions sur le fonctionnement de l’université. Je me suis extrait le mois dernier [janvier 2019] de la responsabilité du master Cinéma/audiovisuel, quasiment un travail à plein temps. D’où la difficulté de se présenter comme enseignant-chercheur [on abrègera en E.C à partir de là] quand les responsabilités et l’animation d’un service public d’enseignement et de la recherche demandent très souvent de s’investir dans des tâches qui peuvent être assez éloignées du « référentiel », c’est-à-dire le texte de loi qui définit mes fonctions.
Cette charge de travail venait contrarier les ambitions de départ que vous placiez dans l’enseignement et la recherche, sujet que vous abordez avec les étudiants.
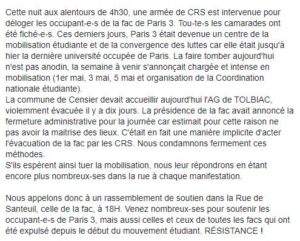
Il y a eu un mouvement étudiant important au printemps 2018 qui réagissait à la mise en place de nouveaux dispositifs d’entrée à la première année d’université, Parcoursup, intégrés à un ensemble plus large appelé « la loi ORE ». Ça m’a permis de parler aux étudiants et étudiantes de ce qu’il se passe derrière, de ce qui organise la vie des études et de l’université. Parce qu’ils passent en général une vingtaine d’heures par semaine à la fac et ne s’en rendent pas forcément compte. Et considérant qu’on constitue une communauté, les étudiants, les E.C et le personnel de l’université, je trouve intéressant d’en parler quand j’en ai l’occasion.
Pendant ce mouvement, vous avez publié une lettre dans laquelle vous informiez la direction de l’établissement de votre décision de vous mettre en grève.
Le 30 avril 2018, vers 4h30 du matin, les forces de l’ordre viennent déloger les occupants du bâtiment D, occupé depuis trois semaines par des étudiant.e.s qui ont décidé d’occuper l’université en réaction à la loi ORE. C’est une occupation à laquelle j’ai participé, dans un établissement où je n’avais pas connu, jusqu’à présent, de mouvements sociaux ou d’opposition particulière à des décisions du ministère. Je suis venu à quelques reprises animer des tables rondes, on a fait une première discussion sur les conditions de travail des E.C, ce que sont ces charges administratives qui occupent beaucoup de temps pour nombre d’entre eux, en quoi c’est un problème qui, d’une certaine façon, nous éloigne de nos fonctions premières.
Le matin, alors que je prépare le petit-déjeuner de mes enfants, le journal de 8h de France Inter annonce que l’université de Paris 3 a été évacuée pendant la nuit. Cela faisait suite à l’évacuation de Tolbiac, un autre lieu de contestation et de concentration de la colère des étudiants. Je suis assez surpris, j’avais cru comprendre que le président de l’université s’était engagé à ne pas faire intervenir les forces de l’ordre. Par ailleurs, l’occupation des étudiants s’est faite de manière exemplaire : ils ont nappé les murs de papier pour permettre aux occupants de s’exprimer par des graffitis sans dégrader les équipements, mis en place des règles de vie très claires et une commission propreté fait que pendant les trois semaines d’occupation, ce bâtiment et la cour intérieure du centre Censier n’ont jamais été aussi propres. Je me rappelle des odeurs de javel dans ce bâtiment. Et quand il y a un graffiti sur un mur, ils appellent la présidence pour connaître le code de la peinture afin de le repeindre. J’ai jugé que le mouvement était respectueux des équipements de service public, très juste dans ses revendications et je ne comprends pas le pourquoi de l’intervention alors qu’il ne se passe rien de dangereux. Quelque chose de juste a été réprimé et il y a quelque part une utilisation politique de la police pour mettre un terme à l’occupation, à ce moment-là une des dernières d’un centre universitaire parisien.
A la suite de l’intervention policière de cette nuit sur le site de Censier de l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, je me déclare en grève administrative et pédagogique illimitée.https://t.co/jFMNdIjvuv
— Alexis Blanchet [En grève] (@AlexisBlanchet) April 30, 2018
C’est la semaine du premier mai et elle sera assez chargée au niveau des contestations [trois cortèges : un le mardi, un autre mené par la fonction publique le jeudi, la « fête à Macron » organisée par François Ruffin le samedi] et du mouvement social contre une politique néo-libérale appliquée par le gouvernement actuellement, à la suite de ceux qui l’ont précédé. Je regarde ma boîte mail et ne vois ni réaction, ni information. Très rapidement, je me dis qu’il faut un geste fort de soutien pour ces étudiants – dont j’apprendrais après qu’ils ont été malmenés. Vient l’idée de quelque chose qui grippe la machine, un appui au mouvement et à la dynamique qu’ont impulsés les étudiants pendant ces trois semaines d’occupation, car elles ont permis des AG du personnel concernant ce Parcoursup qu’on nous demande d’appliquer sans avoir été considérés ou entendus pour sa mise en place. Donc je me mets devant mon ordinateur et commence à écrire un courrier que j’adresse à mon président d’université, à mon directeur d’UFR et à celui du département, à mes collègues. En résulte une condamnation de l’intervention policière, la qualifiant de « geste de trop » et expliquant les raisons pour lesquelles je me mets en « grève administrative et pédagogique ». J’en parle quand même avant avec ma compagne pour voir combien de mois on peut tenir si jamais je ne suis plus rémunéré du jour au lendemain.
Le courrier est écrit, relu et trouvant qu’il y a urgence, je décide de le poster à 11h du matin sur le compte Facebook que j’anime pour les étudiants, le groupe du master, sur Twitter également et puis je pars à un rendez-vous avec des étudiants. Évidemment l’université est fermée, donc on se rejoint au café juste en face, La Rencontre. J’arrive, une étudiante qui m’est inconnue me demande si je suis M. Blanchet et me dit : « Merci pour la lettre ». Il ne s’est pas passé une heure et visiblement ça a déjà été lu. J’en parle avec Matthias Steinle, le collègue avec qui je suis censé évaluer nos 250 étudiants de cours magistral par internet, qui me soutient et on s’accorde à dire que, dans ces conditions, l’évaluation n’aura pas lieu. À la fin de la journée se tient un rassemblement de 200, 250 personnes au bout de la rue de Santeuil pour manifester notre désaccord vis-à-vis de l’intervention policière et qui sera tenu à l’écart de l’université par un cordon de gendarmes mobiles.
Votre lettre va dépasser le cas de l’évacuation de la fac pour pointer un dysfonctionnement plus global.
J’observe ce qu’il se passe. Je fais face aux étudiants depuis le début de mon doctorat en 2004, à Nanterre puis Paris 3, et j’ai connu différents moments de mobilisation. Dans le texte, j’explique n’avoir jamais vu autant de burn-out de collègues, de difficultés à travailler, d’instabilités à gérer. C’est le sentiment qu’on ne ménage pas les équipes, alors qu’on cherche simplement la possibilité de mettre en place des routines de travail, dans la durée, avec les mêmes personnes. Et il y a systématiquement des décisions prises à l’emporte-pièce qui viennent troubler le bon fonctionnement de ces services publics.

À l’occasion d’une AG des personnels de l’UFR Art et médias, je me suis adressé à mes collègues en leur disant qu’à un moment il fallait avoir un mot d’ordre un peu plus vif, plus tranchant, montrer des gestes de désaccord profond vis-à-vis de ce qui sous-tend ces politiques. J’avais parlé d’une sorte de syndrome de Stockholm dont on était tous victime. Et d’une certaine façon, l’écho que le papier a eu, auprès des personnels hospitaliers par exemple, c’est cette idée qu’étant agents du service public, on a le souci que la machine fonctionne à tout prix. Ce faisant, à chaque fois, on accepte des choses et on fait en sorte que les « usagers » ne soient pas lésé.e.s par les nouvelles décisions qui sont prises, qu’on applique le plus souvent à contre-cœur. On n’arrive pas à se mobiliser dans un « non » massif, politique. Et une demande de renégocier complètement les termes de ce qu’est un service public d’enseignement et de la recherche. Le syndrome de Stockholm, c’est l’idée que l’otage a de la sympathie pour le preneur d’otage. Ce sont les politiques qui s’appliquent à l’université depuis une vingtaine d’années et nous sommes les otages qui les mettons en place, petit pas par petit pas, sans que ça n’en transforme réellement le fonctionnement général et sans qu’on n’en revienne aux principes qui sont ceux de l’accessibilité d’un lieu où on développe l’esprit critique, le savoir, où l’on émancipe.
Arrive un moment, probablement depuis les premières discussions vers 2014 autour des possibilités d’une fusion de notre université avec d’autres, où j’ai compris qu’à la vérité, toutes ces politiques, regardées dans une perspective historique et dans ce qu’elles produisent, nous amènent d’une manière certaine à une forme de privatisation de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ça me semble aller à l’encontre du projet défendu à l’université et de ce qui m’a motivé à entrer dans la fonction publique, à me dire qu’être enseignant-chercheur du service public avait un sens, une utilité sociale importante. Je termine la lettre en disant qu’on est en train de détruire un des plus beaux atouts de notre nation et je le pense profondément.
Quels sont les échos de la publication dans la semaine qui suit ?
Le courrier va circuler : je reçois environ 150 mails de gens qui l’ont lu, le Google Drive sur lequel je dépose le texte va être inaccessible pendant 48h. Quelques titres de presse le reprennent à leur tour, des associations de défense du service public également. Le 1e mai, je croise dans le cortège une collègue rennaise qui m’apprend que le texte a été lu en AG. Beaucoup ont l’air de se retrouver dans ces mots.
Au moment où j’écris la lettre, j’envisage les conséquences qu’elle va probablement avoir sur la suite de ma carrière mais, à un moment, il faut aller au feu sinon on accepte l’inacceptable. Ce dont, pour moi et très clairement, l’intervention policière relève. Il vaut toujours mieux que ce soit quelqu’un à qui on ne peut pas reprocher grand-chose qui le fasse et je me considère, en ce printemps 2018, à peu près dans cette situation : j’ai eu une charge administrative très lourde, je viens de sortir du bilan de ma formation [le bilan HCERES] – dans la logique actuelle, on est sans cesse évalués sur ce qu’on fait – et à ce moment, par ailleurs, je travaille à la mise en place de nouvelles maquettes [tous les 5 ans, les maquettes des enseignements changent]. Il se trouve que mon bilan est positif, que je suis élu et que je viens siéger très régulièrement. Et malgré le coup de frein terrible sur mes recherches, je suis à peu près reconnu pour ce que je fais. Que quelqu’un ait tenté de jouer le jeu et, d’un coup, montre le souhait de s’arrêter – « J’arrête parce qu’on crève de ne pas arrêter », c’est une formule qui m’a permis de dire le fond de ma pensée – ça va probablement stimuler les collègues : on ne peut pas laisser passer ça sans rien dire et attendre un retour à la normale.
Le jeudi, je propose aux étudiant.e.s d’avoir une conversation via Twitch, pour leur expliquer en quoi les engage ma grève, parce que ça va toucher l’ensemble des inscrit.e.s dans le master cinéma. 200 personnes vont participer et, étonnamment, très peu viennent me troller. Le plus satisfaisant dans l’affaire, c’est que les étudiant.e.s me défendent. Je bois du petit lait à ce moment-là, couvert d’amour de la part de collègues E.C, d’étudiant.e.s, de collègues du personnel. L’après-midi du lundi, une dizaine de collègues se joignent déjà à mon texte. On sera pratiquement une quarantaine au final, de différents départements de l’université, partageant un même point de vue pour condamner l’intervention. Et, au-delà, la manière dont la loi ORE a été mise en place.
Raconter les événements comme je le fais actuellement me permet de faire un historique.
Une CFVU va suivre le vendredi dans la salle Bourjac de la vieille Sorbonne et notre ordre du jour ne relate rien de ce qui vient d’arriver. À l’ouverture de la session, j’interpelle les collègues qui siègent dans la « cellule de crise » de l’occupation et leur rappelle deux, trois vérités : nos étudiants, leurs copains de Tolbiac les appelaient les Bisounours parce qu’ils étaient organisés, respectueux des lieux et on leur a envoyé les forces de l’ordre. Je leur explique qu’on n’a pas arrêté de montrer nos désaccords sur la politique de l’ESR [Enseignement Supérieur et de la Recherche] pendant quasiment 4 années, qu’on a voté dès janvier et à une large majorité contre l’application de Parcoursup dans notre université et que, sans cesse, cette parole n’est pas écoutée, ne remonte pas aux instances et, forcément, ça crée ce genre de situations.

Je vais fermement tenir ma grève administrative et pédagogique sur les mois de mai et juin. Lors d’une AG du personnel, on avait voté que notre opposition à la loi ORE ne devait pas léser la scolarité des étudiants. Et, discutant avec la secrétaire du master cinéma, Mme Millet, qui craint de ne pas pouvoir gérer la situation sans ma participation en tant que directeur, je propose de faire un travail a minima sur la gestion de la fin d’année et la mise en place de la rentrée. Ça démontre à quel point ces charges administratives sont essentielles pour faire fonctionner nos diplômes. Le département me demande, par la voix du directeur, si je ne veux pas passer la main, ce à quoi je réponds non : je suis en grève et si le conseil de département souhaite me démissionner de mes fonctions, j’en prendrai acte. À la rentrée, la situation n’a pas vraiment évolué : Parcoursup s’est appliqué, sauf chez nous au département Cinéma et audiovisuel puisque nous avons décidé collectivement de ne pas l’appliquer, en faisant une réunion puis un vote puis une consultation en ligne. Je m’en félicite, ce sont des décisions qui montrent qu’il peut y avoir des points de résistance sérieux.
Les dirigeants de l’université n’ont pas protesté contre cette décision ?
On les a mis devant le fait accompli. Chacun d’entre nous avait ses raisons : certains tenaient des positions idéologiques, d’autres des positions pratiques. On est déjà très largement pris par nos activités d’enseignement, alors 6000 dossiers à classer au moment où on a des paquets de copies à corriger… La décision va être assez mal perçue par les élus de l’université. Le président fait le choix de passer le dossier au rectorat, qui produira rapidement un classement. Cinq jours après la livraison des premiers résultats, ceux de l’université arrivent sur la plateforme. Jamais le rectorat ne se priverait de 300 places en 1e année d’une formation dite « en tension » [davantage de demandes que de places].

On a au moins pu discuter entre collègues du département. On a fait fonctionner de la démocratie locale, on s’est affirmés comme E.C capables de prendre des positions politiques, peut-être de désobéissance. Et puis la rentrée arrivant, dans la droite lignée de ce que j’ai appliqué au mois de juillet, je décide de faire cours. En proposant aux étudiants une séance en lien avec les revendications lors d’une journée de mobilisation. Ça me permet de passer le premier semestre mais pour en avoir discuté avec des collègues impliqués dans la rétention des notes, septembre est arrivé accompagné d’un arrière-fond de déprime. « Est-ce que ça vaut vraiment le coup, tout ça ? ». Quelque chose d’important s’est passé au printemps, plus de 70 interventions policières sur les campus en France, ce qui est assez dingue et devrait effrayer tout le monde, alors qu’on s’inquiète de l’arrivée d’un populiste au Brésil.
Voilà à peu près où on en est. Un nouveau mouvement de blocage a eu lieu aux mois de novembre/décembre [2018], tout de suite suivi par une fermeture administrative. Laisser les étudiants à 3°C dehors alors que la demande d’un lieu pour pouvoir se réunir n’a pas abouti, ça ne permet pas de discuter sur le fond des choses, cette fois-ci autour de la hausse des frais pour les étudiants étrangers hors UE. Ce qui arrive à un moment… En termes de communication, c’est renvoyer un jerrican d’essence sur les cendres du printemps dernier, forcément ça repart tout de suite. Cette décision inique, dans la droite ligne des politiques de destruction, finira par toucher tout le monde : les étudiants étrangers hors UE, les étudiants européens, puis les étudiants tout court. Le second semestre s’amorce dans cette ambiance politique-là. J’ai proposé à mes L2 de prendre 10 minutes en début de chaque cours pour leur présenter des textes sur ce qu’il se passe et qui expliquent aussi l’historique de tout ça. Ils peuvent passer jusqu’à cinq ans chez nous, mais ils ne savent pas ce qui s’est mis en place depuis 15 ou 20 ans et qui explique la situation actuelle.
Concernant la réforme « Bienvenue en France », nom paradoxal s’il en est, la présidence de Paris 3 s’est quand même engagée, aux côtés d’autres universités, à ne pas appliquer la hausse des frais.
Il y a eu un premier vote au conseil d’administration en décembre, duquel se sont abstenus le vice-président du CA et le président de l’université. Un des textes condamnait la hausse des frais et assurait que tout serait mis en place pour ne pas l’appliquer. Même le CPU [conseil des présidents d’université] a très tôt désapprouvé cette décision annoncée par le Premier ministre et mise en œuvre par madame Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Je ne vois personne pour appliquer de manière publique cette décision. En revanche, des discours tenus par les uns ou les autres prétendent que, quand même, une petite augmentation ne serait pas totalement illégitime. Le loup est dans la bergerie. Le discours gouvernemental nous parle d’un tabou, celui des frais d’inscription. Il faut leur répondre que c’est un principe : l’accès aux études supérieures est un droit. L’université est un lieu qui forme à beaucoup de choses dont, probablement, la citoyenneté. Et plutôt que de parler réforme, parlons refinancements. Plutôt que de trouver des solutions qui désengagent l’État dans le financement de l’université, appelons à un réengagement ferme, sur un pourcentage à définir – pourquoi pas celui du PIB, tout simplement. Créons des universités, parce qu’on est en déficit chaque année de plus de 25 000 étudiant.e.s. Il y a eu un boom démographique en 2000, ils arrivent à la rentrée 2018 : y a-t-il eu des universités nouvellement construites pour les accueillir ? Absolument pas. Et puis il y a quelque chose inscrit au fronton de nos mairies. Je crois qu’accueillir tout le monde avec des frais raisonnables d’inscription à l’université, c’est une expression claire de ce projet de société qui s’appelle la république.
Vous n’êtes plus directeur des master cinéma et audiovisuel depuis fin décembre dernier.
Je pensais céder la place courant 2019 pour proposer une période de tuilage avec celui ou celle qui me succéderait. Un collègue était disponible et visiblement motivé pour reprendre la fonction, donc on a fait le passage de relais le 1e janvier dernier. J’ai livré un vade-mecum de la direction du master pour fournir des éléments dont on n’a pas forcément conscience en arrivant au poste. Je n’ai pas été recruté comme quelqu’un ayant des compétences de management ou de gestion mais en tant qu’E.C : par rapport à ce que je pouvais apporter à un département et aux qualités qu’on a attribuées à mes compétences de chercheur, à mon activité de publication et communication… Aujourd’hui, on a développé un système d’heures supplémentaires qui justifie que pour 24h de décharge de cours, j’assure la gestion de ce que j’ai appelé pendant quatre ans et demi ma « petite primaire ». J’ai listé dans le courrier du 30 avril tout ce que je n’allais pas faire et, simplement sur les mois de mai et avril, c’était une demi-page de convocations de conseils pédagogiques, de conseils de perfectionnement, de documents à valider et signer, de campagnes de candidatures à mettre en place etc.
Ça invite à avoir un appui plus fort de personnels administratifs : on a une secrétaire pour gérer 300 étudiant.e.s et ce n’est pas suffisant. Est-ce qu’il y a un corps de métier à inventer, quelqu’un dont le travail serait cette organisation, toutes ces questions de plannings ? On peut imaginer bien des choses mais sans refinancement, ce sera inutile. On retombe dans des mesures d’urgence même si on essaie d’organiser des choses, et on termine chaque année en se disant : ça y est, un an de passé sans catastrophes, dans les clous par rapport aux délais, avec les moyens qui sont les nôtres, c’est-à-dire très faibles.
Partie 2 : « Chercheur de banlieue »
Vous êtes maintenant débarrassé de cette charge administrative et de retour à la position d’enseignant-chercheur. Quel est le rôle de ce dernier ?
C’est une responsabilité importante. L’université est un lieu où des générations d’étudiant.e.s vont être au contact d’E.C, désormais moins titulaires que chargés de cours. Et dans mes cours, j’essaie de les mettre au contact de la recherche, produire des enseignements qui posent des questions de méthodologie, de cadre théorique, de compréhension des phénomènes. De discours critiques, aussi, qui, si on les regarde d’un point de vue néo-libéral, n’ont pas une très grande valeur mais du point de vue de la vie en société, de la capacité à comprendre le monde et à travailler son regard, sont essentiels. Détricoter la manière dont Atari a été constituée comme un succès de l’industrie et montrer qu’en fait il y a beaucoup d’échecs dans l’évolution de l’entreprise, qui certes va dominer le secteur à terme mais est un projet assez amateur au départ, ça n’a pas d’application professionnelle en termes d’ « employabilité », de « portefeuille de compétences » – la novlangue du management. En revanche, ça sensibilise les étudiant.e.s : prendre de la hauteur par rapport aux objets, développer une curiosité pour la lecture théorique ou de recherche.
L’entrée dans la vie adulte est un moment important, un temps de maturation intellectuelle. On l’a vu dans le cadre de la loi ORE, se pose la question de l’échec en 1e année. Nombre d’E.C ont connu l’échec à l’université, moi compris : j’ai commencé des études de sciences de la matière qui n’ont pas abouti, un DEUG de socio que j’ai eu toutes les peines du monde à obtenir et puis en 3e année, il y a eu un déclic. Il fallait ces deux ans, commencer à se familiariser avec tout ça, se rendre compte sans forcément le comprendre et d’un coup se dire : « Mais en fait c’est passionnant ce qu’on me raconte. Ça change ma perception des choses, ça va permettre de constituer un horizon de ce que je veux faire dans la vie ». Pour beaucoup de ceux qui ont la chance de passer par l’université, c’est ce qu’il s’est passé et qu’il faut protéger à tout prix.
Être E.C, c’est aussi travailler à cette articulation entre enseignement et recherche, avec une certaine forme d’exigence. Côté recherche, ça évolue beaucoup. Il y a toujours la tentation d’être dans sa tour d’ivoire, avec ses bouquins, son terrain… Et ça fait partie des modalités qui peuvent exister. Mais la recherche se fait de plus en plus en termes de financement sur projet. Le constat ? On passe beaucoup plus de temps à faire des bilans ou chercher des sous pour faire de la recherche qu’à en faire effectivement. Et puis il faut animer une vie d’équipe : on est rattaché à un département mais aussi à un groupe. C’est savoir répondre aux sollicitations des collègues et donc essayer de trouver le bon équilibre parce que le « publish or perish » [publier ou périr] est toujours d’actualité.

Cette réalité de la recherche entrait-elle en conflit avec la conception que vous en aviez ?
Depuis 25 ans, il y a une sorte de course à la publication dans des revues reconnues et qualifiantes. Prenant acte de mon arrivée à Paris 3 en 2011 et d’une première charge administrative qui se cale très tôt alors que je travaille sur de nouveaux cours, je me suis dit : slow science. On va essayer de travailler sur le long terme, sur un unique projet : l’histoire du jeu vidéo en France. Mais pointe parfois le sentiment de diluer ma recherche ou de me répéter. J’ai le souvenir d’une évaluation à l’aveugle par des pairs et d’une remarque bien précise qui disait que le texte était bon « sauf que c’est un peu du Alexis Blanchet ». Soit je me disais : « Formidable, on arrive à reconnaître ma patte » soit : « Tu ne produis pas de nouvelle recherche ». Parce qu’on manque de temps pour aller convoquer des sources neuves, compléter ses corpus, alors on délaie et on ne progresse pas dans ses travaux.
La manière dont je considère le travail de chercheur est assez pragmatique. Je suis un chercheur de banlieue : j’y ai grandi, j’y vis, j’ai fait ma thèse dans une fac de banlieue. Et je travaille sur des objets qui sont à la banlieue des choses. Le jeu vidéo, ce n’est pas un objet central de la pensée contemporaine, ça manque de noblesse. J’ai de l’affection pour la banlieue, c’est un lieu qui dit quelque chose de l’époque contemporaine. Et dans une formule plus footballistique, là où il y a des Zidane de la recherche, je suis un Didier Deschamps, c’est-à-dire un joueur de milieu de terrain, assez laborieux et moins brillant, qui doit bosser mais peut jouer à peu près son rôle là où il est – je ne prends pas en compte le fait qu’il fut capitaine, qu’on soit bien d’accord.
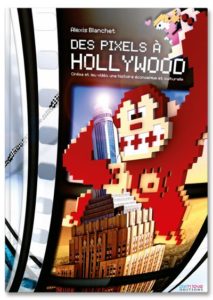
Pour moi, la recherche doit être quelque chose de concret, sourcée, avec une prise de distance analytique face aux objets, un travail statistique que j’aime faire mais qui prend du temps parce qu’il faut constituer des corpus en critères et les analyser. C’est aussi l’idée de travailler pour les chercheurs et se dire que son travail va leur donner de la matière. Pour des étudiant.e.s également et puis plus largement pour un public curieux. Le travail avec Pix’n Love m’assure de toucher un lectorat passionné de jeu vidéo avec un goût pour son histoire, ses contenus… et d’avoir des retours, comme ceux que j’ai reçu d’un jeune docker du Havre ou d’un surveillant de prison. C’est des choses qui n’arrivent pas tous les jours mais de temps en temps et peut-être est-ce utile à ce qu’on appelle la société. À son niveau, ça reste des travaux sur le jeu vidéo, mais je pense que c’est là le travail des E.C. En tout cas, c’est comme ça que je m’y applique.
Comment votre approche, entre la sociologie, l’histoire et l’économie, s’est-elle formée et comment le jeu vidéo est-il venu s’y greffer ?
Je ne suis pas un héritier au sens bourdieusien, mes parents ne sont ni enseignants ni dans la recherche et je n’ai jamais pensé que j’en ferais. Cette idée est venue au moment de mon inscription à l’université de Nanterre en 2004, alors simplement pour avoir une carte d’étudiant et pouvoir réparer des ordinateurs à la fac. Je suis allé me mettre dans un DEA de cinéma parce que j’aimais bien ça, en proposant un travail sur le DVD vidéo et ses usagers. La maîtresse de conférence qui m’encadre alors cherche un.e candidat.e à accompagner dans un travail de thèse et, chance, elle me demande si je serais intéressé. J’ai du plaisir à faire de la recherche et à écrire, j’ai fait un peu de journalisme avec les débuts du web entre 96 et 98, mais je trouve étonnant qu’une E.C pour laquelle j’ai de l’admiration et que je juge exigeante me fasse cette proposition. J’ai 25 ans à l’époque et je lui réponds que je continue à bosser à la fac parce que ça me permet de subvenir à mes besoins, mais je ne me vois pas m’engager dans un travail de recherche sans être financé – mon côté pragmatique.
Je me retrouve finalement doté d’une allocation. Sauf qu’au même moment les chiffres de vente du DVD sortent et le support connaît une phase de plateau annonçant un probable effondrement, alors qu’on parle déjà de la HD et du streaming. Qu’est-ce qui ferait un bon objet de recherche ?
Ma pratique du jeu vidéo s’est d’abord concentrée sur mes années de collégien et quelques expériences précédentes : TO7 puis la NES, la Gameboy, la Game Gear et je me suis arrêté au lycée. J’ai repris en achetant une N64 d’occasion, précisément en février 2000 et, quatre ans plus tard, c’est une activité importante de mon quotidien : j’achète de vieux jeux manqués et je rejoue à ceux que j’ai déjà fait, tout en gardant un œil sur les sorties. Étant sensibilisé à la recherche, je lis des textes critiques, particulièrement ceux d’Olivier Séguret, un critique de cinéma qui se prête à la critique de jeux vidéo dans les pages de Libération, ainsi que les Cahiers du cinéma qui sortent en 2002 un hors-série sur le jeu vidéo, coordonné par Erwan Higuinen. Toute une série d’éléments du jeu vidéo approchée par des tenants de la « culture cultivée », dirait Bourdieu, qui me semble faire part d’un intérêt nouveau sortant l’objet de son statut de simple divertissement et tend à lui trouver, au moins des implications culturelles, si ce n’est des implications artistiques. Dans mon parcours de sociologie, cette capacité à produire de la science à partir d’observations d’un quotidien « quotidien » a toujours éveillé ma curiosité. « Un sociologue dans le métro » : ces choses qu’on ne regarde plus mais qui, dès qu’on chausse des lunettes de sociologue, se révèlent à nous. Je me suis prêté à l’exercice en proposant, dans un cours de sociologie de la culture, un exposé sur Pokémon.
On est en octobre 2004, je suis déjà inscrit, mais il faut que j’enregistre mon sujet de thèse avant la fin de l’année. Je discute avec ma directrice de recherche de l’opportunité de travailler sur le jeu vidéo. Car il faut trouver le bon objet de recherche mais aussi prendre en compte les contraintes qui gravitent autour : un encadrement, celui d’une spécialiste qui a ses champs de spécialité, son approche des objets. Avec Raphaëlle Moine, j’ai la chance d’avoir quelqu’un qui part de l’anthropologie, s’intéresse aux cultural studies et à la culture populaire et entend la possibilité de travailler sur le jeu vidéo. En revanche, je suis dans un département d’études cinématographiques et il va falloir trouver un moyen d’accorder ma proposition au cadre. Si je suis perçu comme un chercheur travaillant sur les relations entre cinéma et jeu vidéo, c’est que j’ai trouvé une réponse à ces contraintes : proposer un travail d’observations des relations entre les deux secteurs avec une thèse bicéphale.

La première partie a donné lieu à Des pixels à Hollywood, plutôt une contextualisation partant des années 70 et courant jusqu’aux années 2000, en essayant de me situer à l’intersection des deux secteurs, faire l’histoire de cette intersection, voir comment elle se déplace… Je croise certains travaux sur l’histoire culturelle et puis la question économique me vient probablement de cours d’économie du cinéma que j’avais dans ma besace, notamment ceux de Joël Augros. J’ai apprécié cette manière de présenter les industries par la dimension économique, avec l’hypothèse d’un probable effet sur les contenus. Sachant que ce qui a parfois été reproché aux bonnes raisons de travailler sur le jeu vidéo, c’est l’explosion économique du secteur.
La deuxième partie de la thèse est un travail sur les adaptations de films de cinéma en jeu vidéo. À l’issue de la contextualisation historique, un objet apparaît, avec une antériorité importante, assez stable sur l’histoire des relations entre les deux secteurs : les films de cinéma transformés en jeu vidéo. J’ai envie d’analyser des jeux. Il y a quelques thèses en cours, comme celle de Sébastien Genvo sur le game design, mais ça ne se fait pas trop à l’époque. Les études cinématographiques sont un lieu d’analyses de contenus et voir si le jeu vidéo se prête à l’exercice devrait être intéressant. L’idée, c’est d’examiner l’existence des relations entre les deux secteurs sur presque quarante années, pouvoir ouvrir sur une critique des débats narratologie/ludologie puis voir avec quels moyens on observe une espèce narrative, la fiction cinématographique, se transformer en une nouvelle espèce à la fois expérientielle, ludique et narrative.

Ce travail d’analyses croisées de films et de leur version en jeu vidéo m’amène à proposer quelques pistes pour penser ce que j’appelle les « configurations nouvelles des fictions industrielles » : entre autres hypothèses, peut-être que la cohérence des récits n’est plus un critère qui fait sens. On accepte tout à fait qu’il y ait quatre Spiderman différents présentés sur les écrans en moins de quinze ans : celui de Sam Raimi, la reprise de Marc Webb puis celle de Marvel avec Homecoming, et enfin le film d’animation Into the Spider-Verse, probablement celui qui vient parfaitement illustrer ça puisqu’il développe en son sein même plusieurs versions du super-héros. Cette observation, je la produis à partir de ce qu’il se passe entre les films et les jeux, voyant qu’il y a une explosion des arcs narratifs, une capacité du jeu vidéo à produire des possibilités qui dépassent outrageusement les cadres définis du récit cinématographique. Pour prendre deux exemples, Anakin Skywalker peut tuer Obi-Wan Kenobi dans le jeu La Revanche des Sith (du point de vue de la cohérence narrative, il ne devient pas Dark Vador, c’est quand même quelque chose) et on peut interpréter Gandalf dans une mission où on va sauver Gandalf dans un jeu Le Seigneur des Anneaux. Ces choses sont observées dans la pratique du jeu et on peut juger que ce sont des formes de court-circuitage des contenus de fiction qui, jusque-là, ont été sous l’empire de la cohérence, en faisant des films à suite.
Pour ma proposition, j’en reviens à des approches narratologiques, des théories de l’adaptation et de la fiction et de l’analyse de jeux. J’arriverai à analyser huit jeux – je pensais en analyser trente au départ mais c’est impossible dans le cadre d’une thèse : un jeu Harry Potter, le Scarface sur PSP, l’adaptation de Happy Feet, L’Arme Fatale peut-être… Il y a un goût personnel, mais je ne me définirais pas comme un fanboy.
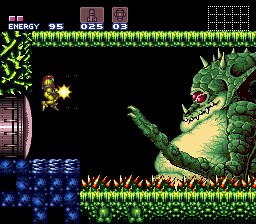
Tomber en 1999 sur une N64 chez un copain d’université et voir Super Mario 64 m’a fait beaucoup d’effet. Je n’ai, à l’époque, pas revu de jeux vidéo depuis six ans et d’un coup Super Mario est en 3D. Il y a comme un choc, un vertige presque, l’ilynx au sens de Caillois, devant ses images : « C’est fou ce qu’il s’est passé pendant que j’étais absent ». Et de me rappeler que j’aimais bien ça, le jeu vidéo, quand j’étais môme. Que ça fait partie de cette culture ado qui m’a construit, probablement avec tous les problèmes qu’elle charriait. Je suis étudiant, j’ai de quoi m’acheter des jeux de temps en temps, par contre lorsqu’on descend dans les vide-greniers et brocantes du coin de la rue, on rachète des sacs entiers de cartouches dont les gens se débarrassent avec joie pour 10 francs. Je me suis toujours foutu d’avoir la boîte et la notice, l’important c’était d’avoir le jeu qui tourne sur la machine, d’avoir des expériences… Racheter Super Metroid pour 1 franc sur un étal de brocante, le mettre dans la machine un dimanche soir et me retrouver debout le lundi à 4h du matin, alors que j’étais censé bosser à 8h, en train de jouer à ce truc sur une cartouche toute poisseuse. J’ai ce rapport-là aux objets, je ne suis pas un fétichiste. C’était des années intéressantes. Si on pense à Conker’s Bad Fur Day ou REZ, ces jeux qui sont arrivés au début des années 2000, ou Ico un peu plus tard… D’un coup, ces objets cassaient les cadres, nous interrogeaient sur le plaisir qu’on avait à y jouer et annonçaient l’explosion du jeu vidéo indépendant.
Prendre le jeu vidéo comme objet de recherche était aussi une forme de pari, qui se pose toujours au début d’une thèse : vais-je pouvoir me constituer une expertise sur un objet qui va faire sens par rapport à l’institution ? Lorsque je me lance, je me dis que tant qu’à bosser sur une thèse, autant la faire sur le jeu vidéo, ça permettra de montrer des choses un peu étonnantes, jouer du côté « chercheur de banlieue » dans des colloques très collet monté et y présenter une séquence de jeu. À la fac en 2004, on peut juger que c’était kamikaze comme proposition de sujet. La suite a prouvé qu’il y avait un intérêt, en tout cas de la part de certains départements.

C’est tombé au bon moment.
Il y a un peu l’effet d’avoir été pionnier. Au moment où j’inscris mon sujet, il y a une thèse en cours à Toulouse et je rencontrerai, dans le cadre de l’observatoire des mondes numériques en sciences humaines, plusieurs jeunes chercheurs.ses qui travaillent sur des objets afférents au jeu vidéo : le game design, l’avatar, des motifs particuliers… On est une petite poignée à l’époque mais l’avantage de s’être lancés, d’avoir pris un risque (raisonnable, faut pas rigoler non plus), c’est d’être arrivés au moment où, au sein des départements, on se dit que c’est peut-être utile d’avoir quelqu’un avec une connaissance de cette littérature scientifique.
Le jeu vidéo se trouve à l’intersection de plusieurs champs de recherche et n’est pas encore catégorisé officiellement comme objet d’étude.
En effet, il n’y a pas de section du CNU [conseil national des universités] qui soit dédiée aux études du jeu vidéo. L’objet va concerner des gens qui vont se faire qualifier en sociologie, en études cinématographiques, en sciences de l’information et de la communication, en philosophie, mais en tant que tel, il n’y a pas de rattachement marqué et c’est assez intéressant. On est dans une période où il y a de multiples approches disciplinaires de l’objet, chacun vient le confronter à ses savoirs, ses approches disciplinaires. Mais on n’en est pas encore à une institutionnalisation académique de l’objet qui entraînerait la création d’une section dédiée et d’un laboratoire d’étude.
Est-ce une chose à laquelle on peut s’attendre ?

Je ne crois pas mais ce n’est pas forcément un enjeu. On commence à voir des intitulés de postes pour recruter des maîtres de conférences qui introduisent « jeu vidéo » dedans et on peut imaginer qu’un département en demande se dirigerait vers des docteurs ayant travaillé sur le sujet. Il y a une thèse, actuellement menée à Toulouse par Sarah Meunier, consacrée à la structuration du champ des études sur le jeu vidéo en France. Nous, on fait partie de cette génération qui a connu une phase d’institutionnalisation au sens où on obtient des postes à l’université : ça fait huit ans pour moi à Paris 3, certains sont devenus professeurs d’université, d’autres intègrent des départements mais continuent de travailler sur le jeu vidéo. Si, dans le cadre d’un refinancement de l’université, il y avait un appel à projet pour un département français d’étude sur le jeu vidéo, peut-être qu’on regarderait la manière dont ça peut s’organiser, mais c’est un peu de la science-fiction.
Le jeu vidéo reste-t-il un objet qui appelle à des études transmédiatiques ?
Peut-être était-ce un moyen de le faire passer à l’époque. On a souvent rattaché mes travaux à cette catégorie, pas mal dynamisée par Henry Jenkins dans les années 2000, qu’était le transmédia. J’en ai fait usage et probablement par opportunisme, sentant que ça me donnerait une visibilité dans ce champ. Un travail entre cinéma et jeu vidéo pouvait intéresser des gens qui s’intéressent aux logiques transmédia, sauf qu’au regard des résultats que j’obtenais, j’en faisais une lecture assez critique. Tel que défendu à l’époque par Jenkins, c’était ce que j’ai appelé un transmédia « de bon élève », c’est-à-dire de gens totalement embarqués dans la proposition éditoriale : « j’ai vu le film, j’ai joué au jeu vidéo, je regarde la série, je lis les comics », qui se soumettent à ce procédé, sont attentifs à tout le travail d’écriture, créent de l’intertextualité entre les objets. Mais ceux-ci ne sont pas fabriqués par les mêmes personnes, qui parfois communiquent très peu entre elles, alors j’ai préféré travailler à l’idée d’un « usager des fictions industrielles », quelqu’un qui va pouvoir entrer dans un univers de fiction par une bd, un film, un livre, un jeu vidéo.

Il y a bien une existence dans les imaginaires de ces fictions industrielles sauf qu’elles offrent de multiples entrées – leurs productions synchroniques (le film, sa novellisation, son jeu vidéo) et diachroniques (le jeu vidéo qui raconte l’univers du film 10 000 ans auparavant) – et qu’un effet de perduration apparaît. Mes gamins connaissent sûrement davantage Star Wars à cause de Lego Star Wars que des films de George Lucas. Ils ont vu le film Les Aventures des orphelins Baudelaire, puis la série Netflix, puis joué pendant des soirs entiers au jeu sur Xbox que j’avais encore sous blister, sur l’écran cathodique qui leur fait siffler les oreilles. Je pense qu’il faut parler des usagers, c’est probablement mon penchant sociologique qui s’exprime.
Le jeu vidéo est un média qui relève d’une forme d’hybridité : on a des images, du texte, des sons, des séquences animées… L’approche transmédiatique peut être un moyen d’approcher le sujet mais aujourd’hui il y a d’autres façons de le penser : la rythmo-analyse que développe Mathieu Triclot, par exemple, en se concentrant uniquement sur les inputs des joueurs.ses sur la manette ou le clavier, ou le travail de Manuel Boutet sur la nostalgie que provoquent les jeux vidéo, ce qui fait qu’on a un rapport aux jeux vidéo même quand on n’est pas manette en main… Le champ s’est ouvert.

Une des hypothèses fortes de l’analyse des adaptations de films en jeux vidéo, c’était que le contexte général dans lequel elles apparaissaient a un effet très important sur leurs propositions ludiques. Elles sont assez peu innovantes puisqu’il faut faire ces jeux rapidement quand la sortie est calée sur celles des films, mais ça n’empêche pas les réussites. Pour reprendre une observation d’Erwan Higuinen à propos du jeu Kuzco, l’empereur mégalo (les objets de recherche nobles, hein), c’est un très bon plateformer 3D sauf qu’il n’est pas reconnu à l’époque parce que le genre est en désuétude et qu’il n’y a encore que les adaptations de films d’animation qui vont vers cette formule. Ces objets imposent les règles du jeu au contenu, aux arcs et à la cohérence narrative des univers et récits et disent quelque chose de nos nouveaux rapports à la fiction.
Dans vos cours et vos textes, on sent une volonté de proximité avec l’interlocuteur qui passe notamment par des anecdotes personnelles apportant des exemples concrets. Qu’est-ce que cela dit de votre approche ?
C’est une routine pédagogique, tout simplement. Devant un amphi de 200 étudiant.es, en fin de journée, il est 18h40, le « Je vais vous raconter quelque chose, peut-être même que ce sera intéressant ! », ça capte l’attention. Travaillant sur ces questions depuis une quinzaine d’années, tout ce que j’observe autour de moi me sert de matière, mais qui vaut pour la possibilité d’illustrer quelque chose. Je sais que si je dis à un groupe d’étudiant.es : « Je vais vous parler de mes enfants », ils vont se dire : « C’est vrai qu’il a aussi une vie de famille, c’est pas seulement un corps qui parle derrière un bureau ».
Hier, je leur ai présenté l’histoire des salles de cinéma à Colombes, où j’ai grandi et j’habite. D’une certaine façon, c’est partager de mon histoire personnelle avec eux, même si l’exemple est illustratif du mouvement des changements de parcs en France. Quand j’échange avec les étudiants et que je parle d’un jeu récent auquel j’ai eu l’occasion de jouer, l’effet d’attention est redoublé. On a par exemple évoqué la sortie d’Apex Legends alors qu’on parlait des genres du jeu vidéo, notamment du battle royale. Ça permet de prendre des exemples plus parlants, parce que si je parle de Super Mario 64, qui a 23 ans aujourd’hui, il y a peu de chances que les étudiant.e.s y aient joué.

Dans les textes, c’est quelque chose que je vise. Il y en a, lorsqu’on les écoute en intervention publique, on les comprend, mais quand ils parlent recherche, ça monte dans les tours. Le chercheur doit être compréhensible par le plus grand nombre. Je n’ai pas la prétention de devenir un grand théoricien, en revanche je souhaite faire mon travail avec honnêteté et rigueur intellectuelle et qu’on apprenne quelque chose en lisant mes textes. Que je parle en public ou dans le cadre de la recherche, on ne verrait sans doute pas grandes différences, et c’est sans doute illustratif de la manière dont je me considère comme chercheur.
L’approche analytique reste parfois regardée avec suspicion, notamment concernant les objets populaires que sont le cinéma ou le jeu vidéo. Il y a chez vous une volonté d’abaisser la barrière qui peut faire paraître la parole universitaire comme cloisonnée.
Des Pixels à Hollywood, malgré son introduction où je joue un peu trop l’universitaire, peut apparaître dans les bibliographies dans le cadre d’un cours sur les industries culturelles, sur l’histoire contemporaine du cinéma, sur les cultures populaires dans la seconde moitié du 20e siècle, et en même temps je sais qu’un lecteur/une lectrice qui ne navigue pas dans la recherche peut aussi y trouver de l’intérêt, ce qui est pour moi une vraie réussite. J’espère qu’on va continuer dans ce sens : un ouvrage dont le plus grand nombre peut s’emparer sans sacrifier à l’exigence intellectuelle. Si c’est ça, je signe dès demain.
Dans la continuité de cette volonté d’ouverture, on note votre récente utilisation de Twitch.
Jouer à des jeux et discuter avec des chercheurs sur Twitch, c’est un truc imaginé avec Mathieu Triclot. Son livre Philosophie des jeux vidéo (2011) étant sorti juste après Des Pixels à Hollywood, on a eu entre 2011 et 2015 la possibilité de faire un numéro de duettistes lors de diverses interventions. Sauf qu’au bout d’un moment, on se connaissait beaucoup trop l’un l’autre. Mathieu est quelqu’un qui aime l’expérimentation et on s’est demandé comment trouver un moyen de parler qui soit adapté à des situations particulières de médiation, avoir une parole d’universitaires mais qui soit agréable et accessible, pourquoi pas ludique. Ça nous a amené à développer le format de la Bingo Conférence, où on tire au hasard des thèmes qu’on va développer, avec une vraie grille de bingo pour le public et des lots à gagner. La première fois s’est faite avec Karim Debbache, puis avec MrMeeea et GingerForce au Forum des Images. Le format a été repris par des étudiants, je l’ai moi-même repris pour une rencontre avec deux journalistes, Pierre-Alexandre Rouillon et Erwan Carrio. Ça marche bien mais après trois ou quatre fois, il faut trouver autre chose.
Cette autre chose, ça été un accident de manipulation, un soir, en jouant à la PS4 : je joue à Trials Fusion et mon doigt dérape sur la touche share à laquelle je n’avais pas touché depuis que j’avais la console, et on me propose de diffuser la partie en ligne via Twitch. Pour vérifier, parce que ça me paraît bizarre, j’avertis les gens sur Twitter et cinq, six personnes viennent voir. Il est 0h45, on est en pleine semaine et on arrive quand même à toucher des gens, je me dis qu’il faut absolument utiliser ça. Le gros problème des médiations sur le jeu vidéo c’est qu’on n’est jamais dans le jeu, il y a des images, des séquences enregistrées. On en a parlé à Marine Le Cozannet, programmatrice du festival Travelling à Rennes, et elle a organisé les streams dans ce cadre. La première année, on s’est retrouvé en milieu d’après-midi au bar gaming le Warp Zone avec une petite dizaine de médiateurs culturels curieux de savoir ce qu’on pouvait faire avec Uncharted 4. C’est pas du tout des Twitch de performance où on fait preuve de bons mots et de bagout : on nous reprochait de tout le temps appuyer sur pause pour discuter animations ou cadrage… On a refait un Twitch sur Alien Isolation dans la salle de cinéma de la Femis, avec un Mathieu Triclot terrifié donc très bavard.

Rapidement, on s’est dit qu’il fallait confronter un spécialiste d’un sujet à nos parties. L’année dernière, j’ai embarqué Laurent Véray, historien du cinéma à Paris 3, et je l’ai fait jouer à deux jeux sur la Première Guerre mondiale, lui qui est spécialiste international de ses représentations. On était accompagnés par Jean-Baptiste Massuet, maître de conférences en cinéma à Rennes, et on a eu une discussion sur ce qui fait que Battlefield 1 transforme la réalité historique. Le lendemain, avec Soldats Inconnus, on était devant un public plus jeune, séance qu’on a refait à Compiègne au mois de novembre avec Brice Roy, game designer en train de terminer une thèse de philosophie des techniques sur le jeu vidéo. C’est typiquement le genre de choses qui bouge un peu les cadres, j’aime bien jouer avec ça.
J’ai poussé la chose un peu plus loin cette semaine : France Culture m’a appelé pour me demander de parler du gore dans les jeux vidéo. J’ai potassé les bouquins de Bernard Perron pour préparer tout ça et en discutant avec l’attaché de production, on se dit qu’on va faire jouer l’animatrice, Adèle van Reeth. Alors j’ai amené un casque VR et Resident Evil 7. On a aménagé un petit espace et elle a joué à une séquence de début de jeu, où on entre dans le manoir et croise des choses un peu dégueux, l’ambiance se déploie. Arrivée au moment où on rejoue ce parcours dans la peau d’un caméraman avant de tomber sur le cadavre d’un compagnon d’infortune, elle avait les chocottes. C’est super parce qu’on a vraiment ce qui fait le cœur du jeu d’horreur : l’attente, l’angoisse, l’expérience, la proximité que permet le casque VR… Ça fait typiquement partie du genre de hacking que j’aime bien et qu’une émission de service public se prête au jeu, c’est chouette.
Twitch est un exercice intéressant, en particulier avec des chercheurs, car ça déstabilise le cadre de la recherche, assez peu spontané au premier abord.

Ça nous met un peu en danger, ce qui n’est pas mal. J’ai préparé les premiers streams, mais je prends en général le rôle de modérateur dans ces situations. On l’a refait lundi et mardi à Rennes, à nouveau dans le cadre de Travelling pour les 30 ans du festival, qui s’attache chaque année à une ville à travers les films qui lui sont consacrés, et j’ai tout simplement proposé le thème de « la ville dans les jeux vidéo ». On a présenté Sleeping Dogs et Lego City Undercover et je me suis mis au même niveau que les collègues qui découvraient les jeux. On a parlé fonction mémorielle, comment j’ai associé un lieu à une fusillade que j’avais vécue, par exemple. Sortir du texte préparé, c’est se permettre aussi qu’il y ait simplement des moments de jeu, où chacun observe et se nourrit. À la fin, on a fait une petite mise à plat où chacun donnait son point de vue et, toujours à ma grande surprise, les gens restent. Je n’ai peut-être pas assez cette culture : pour moi, un jeu est quelque chose auquel on joue avant tout, mais les gamins étaient accrochés. Quand on a refait Soldats Inconnus, c’était des festivalières d’une soixantaine d’années. Maintenant, il faut trouver une nouvelle idée. Peut-être faire un jeu, comme Sébastien Genvo. Ou des Tik Tok. Faut regarder ce qui émerge et s’en emparer pour produire quelque chose.
Partie 3 : « Le modèle du AAA a vécu ses meilleures années »
Vous étiez récemment chez France Culture, vous faites des Twitch, des interventions… Quel besoin pour les chercheurs de se rendre visible ?
Etant perçus comme spécialistes, on est sollicités. Si l’occasion s’est présentée de faire une intervention sur un sujet précis dans un média connu, il y a un « effet de circulation circulaire de l’information » comme diraient les sociologues des médias et d’autres viennent nous chercher. Le fait d’être à Paris et visible sur une thématique plutôt générale pour des papiers culture, sorties cinéma ou jeu vidéo, on m’a repéré comme interlocuteur. Sans courir derrière le fait d’avoir ma gueule à la télévision, j’accepte si je suis disponible et si je me sens légitime, en ayant une attention à la parité des interventions : est-ce qu’il ne serait pas possible d’aller trouver une chercheuse, comme Fanny Lignon, Marion Coville ou Vinciane Zabban, par exemple. On m’a récemment sollicité sur « Bandersnatch », l’épisode de Black Mirror interactif sur Netflix, je leur ai dit d’aller voir Marida di Crosta, qui travaille sur l’interactivité et notamment le cinéma interactif. Il faut faire cet effort pour pousser les journalistes à ouvrir leur champ vers des personnes plus spécialistes et connaisseuses.
Ensuite, il y a l’habitus universitaire. Au sens bourdieusien, c’est-à-dire que certains universitaires adorent voir leur tête partout, vont en jouer et largement communiquer dessus. D’autres ne vont rien dire et je découvre par hasard qu’il y a des émissions passionnantes faites par des collègues. Cet habitus étant généralement dominant, il est un peu mal vu de trop se montrer. J’ai essayé de trouver une position intermédiaire : répondre aux sollicitations dans de bonnes conditions – c’est pour ça que je favorise plutôt le service public. Il faut montrer les universitaires dans le champ médiatique, ils ont peut-être une parole différente à apporter.
Et puis il y a un effet générationnel. Les journalistes ont entre 30 et 40 ans, on est de la même génération et on s’est connus pour certains il y a 10 ans parce qu’on traînait dans les mêmes lieux. Il m’arrive de fréquenter des journalistes de la presse, c’est un milieu plutôt sympa et je suis la carrière de certains depuis un moment. L’intérêt est aussi d’observer comment un milieu professionnel se structure.
La visibilité se recherche également à l’international.
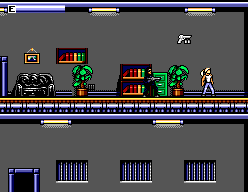
Aujourd’hui, on demande à un.e doctorant.e d’écrire sa thèse, parfois de donner des cours et en plus de ça d’avoir un travail de communication et de publication. J’ai pensé la mienne en trois temps : partir d’abord des communications dans les colloques doctoraux où on présente nos projets entre doctorants, ensuite tenter de passer au national puis faire une communication à l’international pour la fin de ma thèse. J’ai tenu mon programme puisqu’après un ou deux colloques doctoraux, entre autres à l’AFECCAV [Association Française des Enseignants et Chercheurs en Cinéma et Audiovisuel], j’ai pu faire une communication à Montpellier dans un colloque sur le stéréotype. Et en 2009, je suis parti faire une intervention à Montréal avec l’équipe de Bernard Perron dans un colloque international français/anglais qu’ils organisaient sur les adaptations de films d’horreur en jeu vidéo.
Je suis issu d’une famille où ça vient d’un peu partout : une mère belge, un père aux origines américano-irlandaises… L’idée de se dire qu’on puisse avoir un rayonnement qui dépasse les limites du petit monde académique français, c’était une évidence. Les collègues québécois ont été essentiels à ce niveau, car ils sont en contact avec le milieu français, en cours de structuration dans les années 2000, et les milieux anglophones, les scandinaves et les américains. C’est un peu grâce à eux que j’ai pu faire ma première communication. J’ai parlé français mais mon support était en anglais, ce qui m’a permis d’avoir un papier dans Game Informer, la revue professionnelle liée à Gamasutra, dont le journaliste avait aimé ma base de données des films adaptés en jeux. Avec un culot modéré, j’ai informé Henry Jenkins, puisque je travaillais sur ses travaux, que ces données pouvaient l’intéresser. Il les intègrera dès le semestre suivant dans son cours et fera, avec beaucoup d’élégance, une entrée sur son blog (je faisais F5 en boucle sur le blog tous les matins pour voir s’il causait de moi). Gamasutra a également publié un papier qui m’a donné une certaine visibilité du côté anglophone. Elle s’est concrétisée lorsque les Québécois m’ont parlé du projet qu’avait Mark Wolf de faire une encyclopédie du jeu vidéo dont j’ai écrit les entrées sur les cinématiques et sur la France. Mes premiers papiers en anglais.

Est-ce que le français doit exister au sein de la recherche sur le jeu vidéo ?
L’anglais reste la langue dominante dans le domaine. Mais la recherche francophone existe, elle s’est structurée entre les Québécois, les Français, les Suisses et les Belges. C’est une chose que je défends, en ayant une majorité de ma production en français, et aussi en envoyant de temps à autre un bouquin aux collègues internationaux, quand bien même ils ne lisent pas le français. Qu’ils se disent que quelque chose se passe en France. C’est important de suivre cette logique, car on leur doit une partie de la littérature sur le jeu vidéo, et pour défendre notre spécificité. Et une distance aussi : un chercheur français s’intéressant au cinéma hollywoodien depuis la France, c’est un regard extérieur qui analyse les choses différemment. Les collègues qui ont participé au projet LudEspace ont bien aidé. Il y a quelques années, ils sont allés communiquer leurs résultats auprès des scandinaves à travers un papier qui montrait en quoi les game studies traitaient essentiellement de jeux socialement marqués, des jeux « petit bourgeois », ce qui a d’abord été mal accueilli. Et en y réfléchissant, c’est un biais sur lequel il fallait s’arrêter. J’en ai vu les effets rapidement puisque, dans les jours qui ont suivi, j’ai été sollicité par un des chercheurs fondateurs des game studies. Avoir une présence anglophone et aller discuter avec les gens de temps en temps permet au moins d’être repéré.
Lors de votre passage sur France Culture, vous avez été questionné sur la question de la violence dans les jeux vidéo. Doit-on encore interroger la légitimité du jeu vidéo à aborder des thèmes violents ?

Je prends la question de la violence comme un type de discours sur le jeu vidéo. J’avais répondu à une sollicitation du service vidéo de France Culture qui me proposait de faire une vignette sur le gore, dont il avait été question dans l’émission enregistrée juste avant. Une fois là-bas, le journaliste me dit : « Je vais vous poser des questions sur la violence des jeux vidéo ». Ce n’est pas ce qu’on avait prévu alors je lui demande si, en 2019, on en est encore là et, de plus, je suis assez peu légitime sur la question, il aurait fallu interroger Olivier Mauco par exemple, qui a travaillé sur les formes de régulation de l’industrie par rapport aux paniques morales.
Être dans une situation d’arbitre, c’est le problème de l’expert : les médias vous considèrent comme tel, donc votre parole va dire le vrai. La violence des jeux vidéo, je n’en sais pas grand-chose à part qu’on en parle depuis 76. On a dit la même chose des films de gangster dans les années 30, on déconseillait aux femmes de lire des romans à la fin du 19e… Se rejouent autour du jeu vidéo des débats très anciens sur la crainte que font peser de nouvelles pratiques sur une forme de confusion entre le réel et le virtuel, et d’une violence des contenus qui se manifesterait dans la vie réelle du fait de la pratique de ces médias neufs. Donc l’opposition entre une théorie du média prescriptif – « je joue à un jeu vidéo violent donc je vais être violent dans la vie » – et une théorie de la catharsis – « c’est parce que les jeux vidéo sont violents que je peux y exprimer ma violence plutôt que dans la vie ».
En revanche, et comme je le dis à mon journaliste de France Culture, on parle de violence physique, visuelle, il faudrait peut-être parler d’autres formes de violence. Que dire d’un jeu si mignon et écologique comme Pikmin dont les mécaniques sont fondées sur des formes de rapports néocoloniaux aux territoires ? Que dire de l’invisibilité de héros autres que blancs ? Ou de la présence encore minoritaire d’héroïnes ? D’autres formes de violence plus insidieuses ne sont pas interrogées tant que ça par les médias. Heureusement, il y a le travail de Mar_Lard sur le sexisme, tant dans les contenus que les traitements et communautés, les travaux de Fanny Lignon ou les réflexions de Laurent Trémel et Tony Fortin sur l’idéologie qui sous-tend certains jeux. Mais c’est moins visuel, ça répond moins à une sorte de panique morale, quand bien même ça mériterait tout autant d’être interrogé.
Et puis si cette violence est un motif présent dans une partie des jeux vidéo, au même titre qu’au cinéma ou dans la bande-dessinée, c’est qu’il est dans nos vies quotidiennes, dans le fait qu’à 2h30 de vol de Paris, des pays sont en guerre. Personnellement, je préfère que la violence soit dans les jeux vidéo que dans la rue.
Une première phase de maturation de l’industrie du jeu vidéo semble se dessiner, en parallèle de l’évolution des mentalités et l’arrivée de développeurs et développeuses issu.e.s de la diversité.
En adoptant un regard d’historien, on se rend compte qu’ont été assez invisibilisés des gens issus des minorités : des développeurs et ingénieurs noir-américains, des développeuses, des programmeuses. Aujourd’hui, ces noms ressortent, ce n’était pas si monolithique. Je me rappelle de génériques de simulations de football, chez FIFA par exemple, où il y avait beaucoup de noms latino-américains, des gens qui ont une culture footballistique peut-être plus importante que les WASP anglo-saxons. J’ai travaillé sur le développement de jeux vidéo en Inde pour un article, ce qui m’avait permis de découvrir tout un réseau – ça a probablement dû exploser en taille depuis, c’était il y a douze ans. Des développeurs indiens m’avaient donné des informations sur les structures dans lesquelles ils travaillaient, essentiellement de la sous-traitance. Toute une partie d’assets de jeux vidéo, dans mon souvenir des simulations de football américain, était sous-traitée à des studios basés à Hyderabad. Il y a de la diversité dans les petites mains du jeu vidéo ; dans les lieux de pouvoir, c’est une autre paire de manches.

La discussion sur les conditions de travail dans le milieu du jeu vidéo semble amorcée réellement, maintenant, avec les enquêtes qui sont sorties. J’en avais fait l’expérience l’année dernière lors d’une journée de réflexion dans le cadre d’Addon, le volet professionnel qui précède le Stunfest. Dans un printemps qui était en quelque sorte social, la journée de discussion avait largement tourné sur des questions comme : « Comment travaille-t-on dans cette industrie ? Comment l’intègre-t-on ? Comment fait-on pour y bosser plus de 10 ans et pas en sortir essoré.e ? ». Les choses sont en train de se faire.
Vinciane Zabban et Hovig Ter Minassian travaillent actuellement sur des entretiens avec de jeunes professionnel.les du jeu vidéo pour comprendre les trajectoires de travail et Thomas Versaveau, de la chaîne Game Spectrum, a sorti son documentaire sur les conditions de travail dans le milieu. Il est venu pendant l’occupation de Censier lors de laquelle des professionnels du STJV étaient venus parler avec les étudiants, aux côtés de Sébastien Delahaye et Cécile Fléchon de Canard PC qui avaient participé à l’enquête, en association avec Mediapart et révélée fin 2017/début 2018. Il y a des prises de conscience et probablement une génération de professionnel.les du milieu qui, dans un contexte général de détérioration des conditions de travail s’appliquant à peu près à tous les niveaux de la population, commence à défendre ses intérêts, considère peut-être l’hypothèse de se syndiquer pour constituer un rapport de force avec leurs employeurs.
Est-ce une évolution qui se traduit également au sein de la recherche sur le jeu vidéo ?
On voit s’affirmer des chercheuses issues d’un travail doctoral portant sur le jeu vidéo, comme Marion Coville ou Haude Étienne. À l’international, on peut penser à Maude Bonenfant au Québec ou Melanie Swalwell en Australie. Il faut maintenant qu’elles trouvent des places dans les institutions et j’espère qu’un travail sur ces problématiques a lieu, travail qu’il va falloir accompagner et stimuler. Du côté de la diversité au sens de personnes racisées – d’une certaine façon et peut-être à tort, je ne les considère pas comme racisées mais comme chercheur.ses –, avec le travail que fait Mehdi Derfoufi sur les questions des représentations des minorités dans les jeux, des chercheurs comme Selim Krichane ou Selim Ammouche, on sort un peu du milieu bien blanc auquel j’appartiens, ce qui est gage d’une certaine forme de diversité et d’enrichissement dans nos manières de penser l’objet. Les travaux de Carl Therrien, portés sur l’histoire de ces minorités à la marge, des objets qu’on oublie, sont également sensibles à ces questions. J’ai le sentiment que les choses sont établies pour essayer d’avoir une recherche équilibrée, ouverte et qui permette à tous les points de vue de s’exprimer.
Activision a récemment annoncé des bénéfices records et, dans la foulée, le licenciement de 800 personnes. Les conditions de travail, la discrimination et d’autres problématiques commencent juste à être abordées par l’industrie, y compris celle des conditions de production des jeux et des machines, notamment leurs répercussions écologiques.
Comme industrie culturelle, qui peut à la fois être entendue dans un sens large et au sens de l’école de Francfort, elle s’insère dans un capitalisme généralisé. Et cela pose la question des conditions de fabrication des supports, gourmands en métaux rares qu’on va chercher sur des territoires exploités pour ça, en Afrique entre autres. On interroge le bilan carbone de tous ces services proposés avec des machines connectées et gourmandes en énergie. C’est un questionnement qui semble se faire jour : est-ce qu’on va pouvoir continuer dans l’escalade de performance technique et de machines toujours plus énergivores ?

L’industrie va trouver des limites, notamment la capacité de pouvoir d’achat des publics ; ces machines ont fonctionné grâce à leur prix abordable, avec un modèle d’exploitation basé sur la vente de logiciels qui permet aux consoliers de faire leur marge. Des rapprochements entre fabricants s’observent, Microsoft et Nintendo en ce moment. Le risque serait de quitter une forme d’écosystème en oligopole avec différents acteurs pour avoir juste une plateforme de jeu, aux enjeux de pouvoir et de décisions éditoriales importants dont on peut craindre des effets d’assèchement de la créativité. Il est certain que ces questions vont se poser. Peut-être qu’une entreprise comme Nintendo a déjà amorcé une réflexion sur ces questions-là, en faisant le choix avec la Wii il y a quelques années, d’avoir une forme de stagnation technique. La communication n’était pas axée sur les performances techniques, ce qui ne l’a pas empêché d’être un succès mais aussi d’accueillir des jeux innovants et réussis comme Super Mario Galaxy, pour moi un des meilleurs jeux des années 2010.
Cela veut-il dire que les formes de jeu à venir prendront en compte ces nouvelles conditions de consommation ?
Le marché va décider des choses en termes de capacités des joueurs à pouvoir investir de l’argent dans ces machines et du temps pour s’y consacrer. Je crois avoir lu des déclarations d’un responsable de Netflix qui disait que leur concurrent direct était le temps de sommeil.

En même temps, on peut observer des phénomènes intéressants : le rétro gaming, ressortir ses vieilles consoles et acheter ses jeux sur des étals de brocante, qu’on peut interpréter comme des pratiques visant à éviter la surconsommation. Ou des habitudes de jeu exclusives : parmi les joueurs de Fortnite ou de FIFA, certains achètent ce seul jeu et une machine, ce qui n’en fait pas des consommateurs intéressants pour l’industrie, même si les éditeurs, eux, sont assurés de vendre leurs copies annuelles [et les DLC sont, aujourd’hui, une forme incontournable de revenus]. Ira-t-on vers des consoles achetées en coopérative ? De nouveaux modèles vont exister, d’autant plus que par l’explosion des prix de l’immobilier, on se retrouve avec des adultes engagés dans la vie active qui partagent un logement à 3, 4 et sont tout à fait contents d’avoir une console pour la coloc’.
Je désigne des micro-phénomènes mais ça dessine quand même un ensemble qui va devoir être pris en compte. On a possiblement passé une période où les volumes de machines vendues vont progressivement baisser. De même que le jeu se déporte aujourd’hui sur d’autres appareils : le téléphone portable, la tablette, qui elles aussi sont énergivores mais peuvent avoir l’intérêt de concentrer en un seul objet toute une série d’usages et de services… Peut-être va-t-on porter notre attention future sur d’autres choses, redécouvrir des formes de sociabilité qui se font sans le jeu ; au détour des questions politiques, qui sait. Je suis assez certain que le média va s’inscrire dans la durée et qu’on jouera aux jeux vidéo dans 100 ans, mais différemment. Deux pistes se dessinent selon moi : soit une forme assez fragmentée, des communautés qui se retrouvent autour d’objets type Raspberry Pi, soit, si le néo-libéralisme continue dans sa voie, une forme concentrée, avec un monopole, une plateforme et des consoliers historiques devenus simples éditeurs.
L’ambivalence entre le poids économique de l’industrie et ses origines à la marge est étonnante. Elle se retrouve au sein de la production, partagée entre les projets à plusieurs millions de dollars et les jeux développés par une personne, distribué gratuitement ou pour une somme dérisoire.
La catégorie du détournement, que Mathieu Triclot a d’ailleurs travaillée autour de la culture hacker, me semble être un invariant de cette industrie. Des logiques de détournement, on en trouve sans cesse : le speed-running, l’exploitation de failles dans le jeu… sont des expressions qu’on repère historiquement très tôt et qui visent à détourner des écrans radar, d’oscilloscopes, la prise antenne des écrans de télévision.
L’oligopole reste une structuration assez classique des industries culturelles, avec quelques acteurs majeurs et un écosystème assez large d’éditeurs de différentes tailles. Des phénomènes comme Minecraft il y a quelques années ont été observés, donc des créateurs seuls peuvent visiblement développer une formule qui a une chance de rencontrer un succès mondial dans un environnement très largement connecté. En comparant les années 2010 aux années 70, on voit que le secteur se globalise quasi immédiatement : en quelques mois, des copies japonaises de Pong sont distribuées, ça dit la vitesse à laquelle vont les choses, même il y a 50 ans. Mais là, en termes de diffusion, en s’appuyant sur toute une série d’infrastructures de communication, on peut avoir un phénomène comme Apex Legends qui, il y a 10 jours, sort de nulle part et gagne 25 millions de joueurs, là où il a fallu plusieurs semaines à Fortnite. Tout est très accéléré, c’est aussi une caractéristique de l’époque.
Je pense qu’on aura toujours cette ambivalence, cet équilibre, surtout à un moment où les outils de développement de jeux semblent plus accessibles. En même temps, toute une série de fonctionnalités demandent une expertise qui n’est pas à la portée de tout un chacun, mais il y a une diversité intéressante, qui a pu exister sous d’autres formes dans les années 80. Pendant une période assez réduite, car là aussi certaines configurations poussent à l’internationalisation de la production, des thématiques très franco-françaises apparaissent dans les jeux d’aventure, commercialisés ou simplement disponibles dans les listings de code de revues spécialisées. C’est le propre des industries culturelles de produire ces formes, par la marge, et parfois il arrive que ce qui vient de la marge devienne dominant ou pousse à des formes dont le marché se réempare : Minecraft racheté par Microsoft, PUBG repris par l’éditeur du moteur… Ce qui fonctionne est rapidement repéré et réintroduit dans des logiques marchandes. Il serait intéressant de voir, notamment avec Pierre-Yves Hurrel qui travaille sur les jeux amateurs, si une économie non-marchande du jeu vidéo peut se redévelopper. Il va peut-être se passer des choses, dans l’hypothèse d’une fragmentation des communautés de joueurs et joueuses.

Ce qu’il se passe sur une plateforme comme itch.io appelle des logiques de médiation. Comme dans Canard PC, où une veille sur les jeux accessibles en ligne faisait régulièrement ressortir des petites perles. Ce que faisait aussi Écran à Libération, avec Erwan Cario et Camille Gévaudan, dans la catégorie « Chronophages ». Je me suis fait avoir tellement de fois. Ou encore l’Oujevipo, créé par Pierre Corbinais. Ces médiateurs sont importants, pour que les dominants du marché, avec leurs logiques de saturation, n’étouffent pas toute cette diversité essentielle au renouvellement des projets plus ambitieux. Le modèle du AAA a certainement vécu ses meilleures années. Il continuera à y en avoir mais pas dans la logique qui voulait que tous les studios aient le leur.
Partie 4 : « Qu’est-ce qu’on fait du jeu vidéo ? »
Votre prochain ouvrage, Une Histoire du Jeu Vidéo en France [edit : anciennement French Touche], est celui où vous abordez pour la première fois le jeu vidéo seul comme sujet principal.
À la fin de mes recherches pour l’entrée commandée par Mark Wolf, il y a plein de points aveugles. Vers 2012, Pix’n Love me propose de refaire un bouquin ensemble avec comme sujet le jeu vidéo français. Avec Guillaume Montagnon, qu’ils me présentent, on se demande s’il ne vaudrait pas mieux aborder le jeu vidéo en France, sujet plus large mais qui permet de faire une histoire ouverte sur le monde. Avec ce que j’appelle « l’instinct du chasseur » de Guillaume, on va faire un travail sur les sources secondaires, donc la presse professionnelle, grand public et généraliste, et une soixantaine d’entretiens répartie sur 7 ans de recherches. En ayant à cœur de ne pas faire une histoire des « grands hommes » du jeu vidéo mais celle d’acteurs et d’actrices qui, à un moment ou un autre, par une fonction, un parcours professionnel, se retrouvent dans une situation où ils ont quelque chose à dire sur ce qu’il se passait : construire des bornes d’arcade en France, distribuer les jeux pour micro, les développer sans être une tête d’affiche…
Jusque-là, j’avais plutôt exploité dans mes textes la veine des relations cinéma/jeu vidéo qui était mon cœur de recherche. Là, on partait du constat que les historiens n’avaient pas vraiment fait le travail. Il s’avère qu’une mémoire est en train de se perdre, des gens dont le témoignage est important disparaissent. La personne la plus âgée qu’on a rencontrée, Paul Braffort, avait 93 ans au moment de l’entretien et il est décédé au mois de mai 2018. Les collègues connaissent ses travaux du début des années 80 mais sont surpris d’apprendre qu’il est un des « premiers hommes » du jeu vidéo en France, dans les années 60.

C’est un bouquin qui nous fait aller dans la veine de l’histoire culturelle et économique, avec quelques éléments d’histoire sociale puisqu’on parle d’ouvriers et d’ouvrières, de petits commerçants et leurs boutiques – thème déjà exploré par les travaux de Colin Sidre. Une des réussites, par exemple, serait qu’on intègre l’idée que le terme « arcade » n’a pas de sens dans les années 70 en France, il n’est pas utilisé. Le secteur dans lequel on va exploiter ces nouvelles machines avec écran les appelle, expression géniale, « automatique de divertissement ». Et ce qu’on décrit, et qui va peut-être frustrer, c’est un rapport au jeu commerçant. Ce sont des objets de commerce. Une borne d’arcade, déjà, on la désigne toujours avec un article défini : « le Space Invaders », « le Pac Man ». C’est un meuble, en fait. Et on s’intéresse moins à ses contenus qu’à sa solidité, son poids, son encombrement… Tout l’effort dans l’écriture a été de s’approprier ce vocabulaire pour le travailler dans le texte, donc de parler « d’automatique de divertissement », de « caisse », de « plaque ». On a un témoin qui parle du « bouclard », la boutique en argot. Comme ça s’appuie sur des entretiens, on a essayé de faire en sorte que cette voix soit aussi entendue. Reformulée pour que ça passe mieux à l’écrit mais qu’il y ait de cette oralité, de ce ton.
Malgré le travail que vous faites sur l’histoire du jeu vidéo français, gardez-vous toujours un œil sur les liens qu’il peut y avoir entre cinéma et jeu vidéo ?
Je me sens un peu dépassé et, actuellement, j’ai l’impression de clore ce chapitre. Après 15 ans de travail sur ces thématiques, l’histoire d’un domaine, commerciale notamment, semble plus correspondre à mes intérêts. Je ne veux pas terminer ma vie en étant toujours sur ce sujet, j’ai envie de parler d’autres choses, qui ne sont d’ailleurs pas forcément liées au jeu vidéo. Il faut laisser à d’autres le soin de poursuivre. Je n’ai pas vu Jumanji : Bienvenue dans la jungle, Happy Birthdead, le dernier Tomb Raider, Rampage… La liste s’allonge et je me rends compte que je ne suis pas du tout au contact de ces objets-là. Par ailleurs, je vois des choses tout à fait passionnantes qui s’écrivent. J’étais très satisfait que CinémAction consacre un des derniers numéros à cette question. On m’a offert l’opportunité de le préfacer, un bel honneur sur une collection qui a fait partie des premiers bouquins de cinéma que j’ai acheté vers 14, 15 ans. C’est toujours chouette de s’y retrouver.
La question maintenant, c’est « Qu’est-ce qu’on fait du jeu vidéo ? ». Mes méthodologies de travail ne pourraient-elles pas être appliquées à d’autres champs, alors qu’il faut peut-être penser à passer une habilitation à diriger des recherches. Même si, dans le contexte actuel, je m’interroge beaucoup sur le fait de devenir professeur d’université. Je me suis pas mal grillé par mes prises de position et je me rends compte que la structure est d’une telle puissance qu’être professeur, c’est être contraint, au moins un peu, de jouer le jeu des politiques actuelles. J’ai suivi à Nanterre les cours de Michel Guillou en sociologie et anthropologie, qui est resté toute sa vie maître de conférences. Vingt ans après, je commence à comprendre, connaissant sa position concernant la force des collectifs sur l’individu. Il nous disait que l’individu n’existait pas, une position radicale, mais je vois aujourd’hui se dessiner la force qui, dans certaines fonctions, vous transforme complètement.
Et dans le même temps, je dois répondre chaque mois à des sollicitations de jeunes gens voulant faire des thèses sur le jeu vidéo. Alors je me dis qu’il faudrait un personnel pour leur permettre de développer leurs travaux, pour que la recherche française ne se limite pas aux quelques-un.e.s qui sont en poste dans un contexte général réellement catastrophique. Les postes sont sortis récemment et il n’y a rien, certains docteurs n’ont même pas l’espoir de candidater à un poste. Toutes ces questions m’animent, mais je vais probablement laisser à d’autres le soin de la thématique. On va accompagner la sortie de Une Histoire du Jeu Vidéo en France [edit : anciennement French Touche], ce qui va peut-être amener des petits travaux complémentaires sous formes d’articles de recherche. La sortie du livre va idéalement provoquer des témoignages.
Je garde en tête que l’industrie vidéographique, centrale pour étudier nos rapports à l’audiovisuel, n’a absolument pas été explorée du point de vue de ce qui s’est passé en France. Dans un cours, j’ai décidé de consacrer du temps à la question : comment vient la vidéo cassette et que change-t-elle ? Et derrière ça comment viennent le dvd, le streaming, Netflix. Pour expliquer comment se structurent ces offres et ce qu’elles changent dans nos rapports aux œuvres. Cet environnement s’est constitué dans les années 70 via un milieu de revendeurs d’électronique grand public, qui ont d’ailleurs parfois vendu aussi de la console de jeu vidéo. Je serais bien en peine de trouver ne serait-ce qu’un gérant de boutique des années 70, qui pouvait être ce qu’on appelait un « philipard », un revendeur Philips, pour avoir un témoignage de la manière dont Philips leur a proposé son format de cassettes, comment ils ont développé les premières formes de vidéo-club… Ce sont des sujets qui m’intéressent, il y a une forme de cohérence par rapport aux premiers travaux.
Et puis j’ai d’autres idées en tête. Pourquoi pas un travail sur le cinéma de Simon West : Les Ailes de l’Enfer, la première adaptation de Tomb Raider, Le Déshonneur d’Élisabeth Campbell, un thriller assez incroyable pourtant perçu comme bas de gamme. Voir s’il n’y a pas un auteur derrière Simon West, ça peut paraître fou, non ? Entre une tradition des études cinématographiques et un travail de recherches sur un individu en gardant ma vision de sociologue, convaincu qu’un auteur, c’est une construction et pourquoi pas lui alors qu’il répond à beaucoup de critères qui font l’auteur, au même titre qu’un McTiernan ou un Cameron. De là, je regarderai les relations cinéma et jeu vidéo avec affection.
Merci à Alexis Blanchet pour le temps qu’il nous a accordé, à Morgan Pokée pour nous avoir aiguillé et à Julien et Audrey.

Seastrom
C'est la Loire qui coule dans les veines de Seastrom, mélangée aux subtilités de la vaporwave. Possibilité de l'amadouer en lui parlant indés et D&D (Dreyer et Digimon).
follow me :







Articles similaires
Le jeu vidéo en Asie du Sud-Est - Première partie : ces pays où tout reste à faire
mai 26, 2023
Les meilleurs mods d'Outer Wilds
avr. 20, 2023
Simulateurs de train : y’a de quoi fer
mars 14, 2023