Cette fois-ci dans Partie Rapide, Seastrom s’extasie devant Ynglet, drôle de platformer de Nifflas et un peu moins devant Ninja Gaiden Master Collection, ressortie à sec des aventures modernes de Ryu Hayabusa.
Ynglet
On le surveillait du coin de l’œil et voici qu’il débarque à la faveur d’un Guerilla Collective où les dates de sortie se sont faites rares : Ynglet s’est en effet permis une sortie surprise, avec pour lui une proposition claire, colorée et à petit prix. Accompagné à l’édition par l’aura bienveillante de Triple Topping, une des révélations indé de 2020 grâce au superbe Welcome to Elk!, Nicklas Nygren (alias Nifflas) retravaille ici un projet de game jam datant de 2013 et livre un jeu qui a parfaitement cerné ce qu’il entendait partager : simplicité et fluidité, pour un plaisir des sens et de jeu à la fois immédiat et constant.
Ynglestructible
Le petit monde d’Ynglet s’observe presque comme au microscope, petite cellule de sérénité où l’on traîne gentiment devant la télé avec les copains. Dommage qu’une météorite vienne s’exploser pile sur le coin de notre bulle isolée, donnant naissance à tout un monde qui reprend, ô hasard hasardeux, la vue aérienne de Copenhague où sont basés Nifflas et Triple Topping. Va s’ensuivre une visite informelle de la ville mue en recherche de nos petits potes planctons, de niveau en niveau, comme autant de quartiers ré-imaginés à plat, minimalistes et en couleurs. Il faut s’habituer, lors des premiers niveaux, au choix adopté par le développeur : à première vue, la caméra parait fixée au-dessus de l’action ; on s’aperçoit pourtant très vite que la gravité est bel et bien présente et que la progression se fait vue de côté.
Le twist de gameplay autour duquel tourne Ynglet, c’est de proposer « un jeu de plateforme sans plateformes ». La formule est vraie, mais ne bouleverse pas pour autant la conception qu’on peut avoir du genre : des trous, il y en a, et on tombera dedans un paquet de fois. Ici, le sol est troqué contre des formes géométriques fermées dans lesquelles on évolue librement, séparées entre elles par du vide. Pour progresser, il faudra passer de l’une à l’autre avec plus ou moins d’agilité, en prenant soin de bien doser son élan et de se servir au bon moment du dash, qu’accompagne un slow motion bienvenu lorsqu’il s’agit de viser. Court (comptez 1h30 pour en faire le tour), le jeu est agrémenté à chaque niveau de plateformes au fonctionnement différent qui renouvellent constamment ses dynamiques. Les unes s’effacent à notre approche, les autres nous expulsent au bout de quelques secondes, et il faut également compter sur des lignes bien pensées, contre lesquelles dasher pour emprunter une sorte de couloir, ou sur lesquelles rebondir, à condition de ne pas dasher à travers. L’agencement des niveaux s’en trouve à la fois homogène et très varié, et se parcourt rapidement avec instinct, la direction artistique adoptée (due à Sara Sandberg) ne sacrifiant pas la lisibilité à un style bariolé.

Vient rapidement à l’esprit que Nifflas a tout compris au game feel induit par Ynglet. En fait, on pourrait dresser un parallèle entre le squelette du jeu et sa direction artistique, tous les deux menés par une envie de simplicité, de claire compréhension de leurs enjeux, creusée jusqu’à la sophistication. Cette adéquation serait une explication possible au sentiment de plénitude ressenti face au jeu, où tout semble pesé idéalement, où une explosion de couleurs vient habiller une bulle faite d’un trait noir sur fond blanc. Suivant un même schéma, la progression dans les niveaux est généralement fluide et sans obstacles particuliers, mais des collectibles clairement indiqués parsèment le chemin, et les attraper sera l’occasion d’observer des constructions un peu plus alambiquées – à l’instar des niveaux bonus débloqués une fois la fin atteinte. Et on pourrait dire la même chose de son habillage sonore, présenté comme « inutilement complexe », qui se sert des actions en jeu pour composer une bande-son adaptative immersive.
Ce principe de simplicité prôné par Ynglet évolue en accord avec celui d’accessibilité. Un stick et une seule touche seront nécessaires pour parcourir les niveaux, la variété se déportant aux environnements au fil de la progression. Et, comme une confiance accordée aux joueurs et joueuses, la possibilité de définir n’importe quand ou presque ses checkpoints vient compléter une souplesse de tous les instants. Des options d’assistance exhaustives, influençant la vitesse de jeu, les trajectoires, la force de gravité et le contrôle aérien, viennent parfaire ce tableau, pour un jeu prêt à s’offrir à tous. La proposition d’Ynglet nous a d’abord rappelé celle de Hohokum, moins dans l’ambiance carnavalesque que dans cette esthétique où les lignes et fresques colorées font jeu – le côté contrôle d’un spermatozoïde aussi. Mais c’est plus vers qomp, sorti en début d’année par Stuffed Wombat, qu’on se tournerait au final. Structurellement, les deux jeux partagent une volonté d’aller au plus direct, confortant l’importance d’une idée de gameplay simple et d’un level design poussé face à l’empilement de systèmes. Une efficacité exemplaire, accessible à toutes les bourses et expériences. On ne sait pas quoi demander d’autre, à part que cet exemple soit suivi.
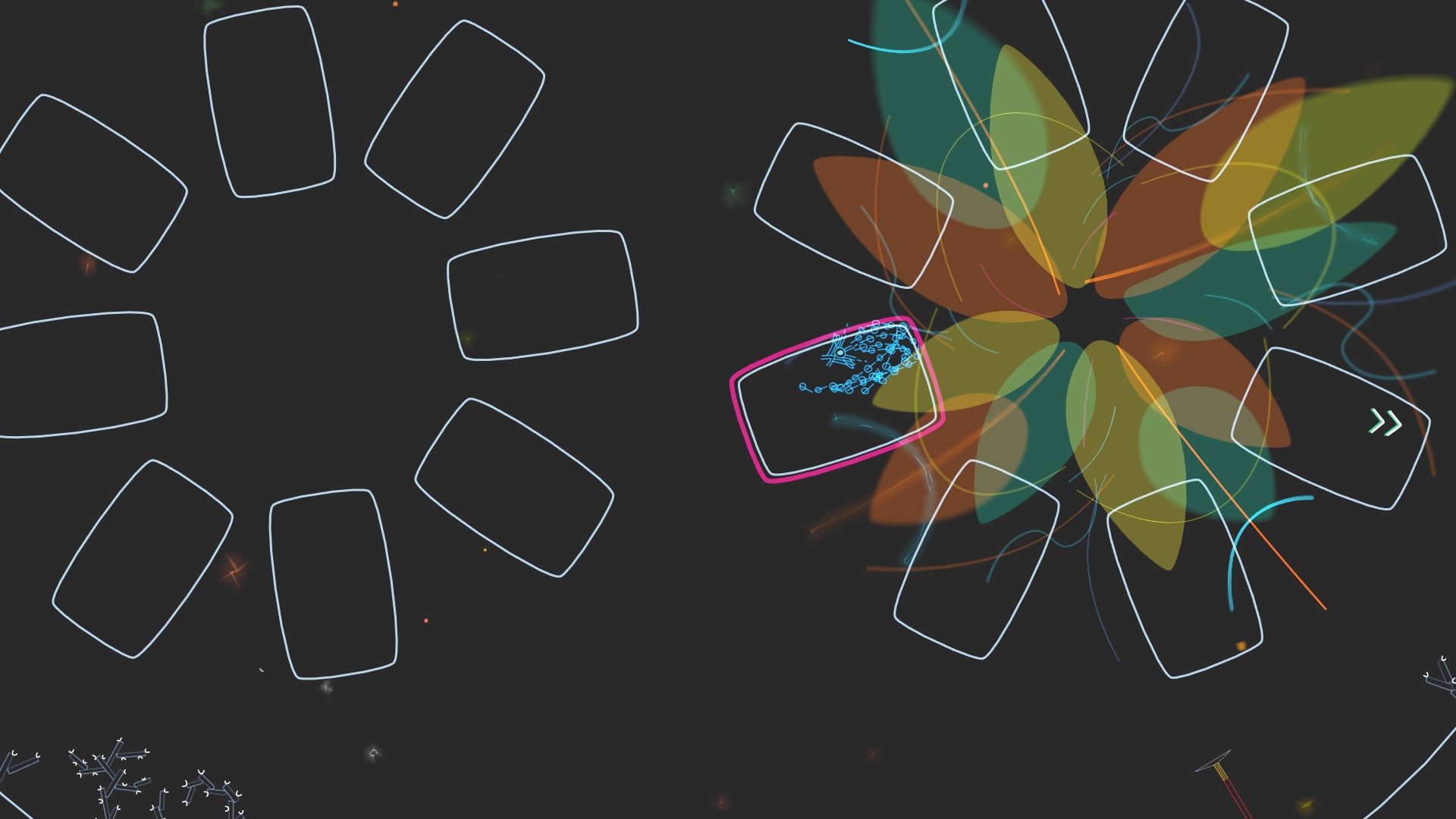
Ynglet a été testé sur PC via une clé fournie par l’éditeur.
On ne sait pas s’il en était réellement parti après Knytt Underground, mais le retour aux affaires de Nifflas avec Ynglet est une franche réussite. Concis, simple et réfléchi à la fois, ce fort joli jeu de plateformes « avec un twist » semble couler de source, et sa philosophie du jeu vidéo avec lui.
Ninja Gaiden Master Collection
Alors, les gamers, on a remporté sa carte de gamer ? On y accumule les tampons des jeux les plus difficiles qui existent en les faisant avec une main dans le dos, les doigts brûlés, les yeux bandés et Zemmour qui nous suçote le lobe de l’oreille ? C’est bien, bravo à vous. Mais ne seriez-vous pas un peu jeunes pour avoir connu les affres que promettait la trilogie Ninja Gaiden ? Pareil ici : à peine le souvenir d’une démo un peu cracra sur les bornes du Auchan de Chambray-lès-Tours qu’on avait approchée le temps que les parents n’étaient pas dans les parages.
Depuis, FromSoftware a redynamisé les logiques de difficulté dans les jeux d’action avec une décennie de Souls et dérivés, entraînant à sa suite tripotée de studios heureux de constater que le public répondait présent. Parmi eux, on a retrouvé Team Ninja, a qui échu le projet maudit Nioh, développeur original de Ninja Gaiden – version Xbox, s’entend. Promesse de masochisme vidéoludique, l’annonce de cette Master Collection fleurait bon l’opportunisme comme un nouvel accès facilité à une série marquante. Mais à l’heure de Sekiro et consorts, quel regard porter sur les aventures du ninja en combi cuir ?
Ninja Gaiden Stigmates
En réalité, la comparaison avec le shinobi de From est plus thématique qu’autre chose. Les Ninja Gaiden (en tout cas leurs versions Sigma et Razor’s Edge pour le troisième, revisitées) s’inscrivent dans la lignée des jeux d’action des années 2000, comptant sur le rythme insufflé à la linéarité de leur aventure. Le premier tendait pourtant un peu vers l’ouverture, en faisant visiter des zones qui demandaient l’activation d’interrupteurs pour atteindre la suite du niveau. Un tantinet d’exploration bienvenu, pas incroyable pour autant (les niveaux ajoutés avec la version Sigma, aux commandes de Rachel, sont nullissimes), mais plombé par la réapparition des ennemis et particulièrement par un placement des points de sauvegarde obsolète, source de perte de temps irritante. C’est que son système de combat, technique et vif, au timing punitif, souffre de caméras fixes très datées qui, peu adaptées aux combats contre les nuées d’ennemis, ajoutent de l’injustice à la difficulté élevée de base. Il est compliqué de se sentir maître de ses mouvements quand les opposants te sautent dessus depuis le hors-champ ou que les motards te dérapent sur le museau sans prévenir. Comme tout ce beau monde a, de plus, l’intelligence de t’attaquer en même temps et de toutes parts, recommencer en boucle en maudissant la visibilité devient vite la norme.

Pour ses suites, Team Ninja a fait le choix de se concentrer sur l’orientation beat’em up du titre. Plus de suites de couloirs et d’arènes, mais pour une progression plus rythmée. À ce titre, Sigma 2 est sans doute l’opus le plus carré et agréable à parcourir. Embrassant son côté série B avec malice dans un scénario qui nous fait notamment affronter la Statue de la Liberté, il a l’avantage de fournir un tuto plus clair et une interface bien plus accueillante – l’action se fige lorsqu’on ouvre le menu rapide, une liste des combos est fournie. Surtout, la linéarité permet une progression mieux pensée et moins frustrante. La refonte du système de dégâts, au grand dam des chantres d’un jeu vidéo qui se pratique avec les couilles, laisse plus de marge lors des combats tout en demandant de rester vigilant jusqu’au prochain point de sauvegarde. Une suite pensée vers plus d’ouverture sans pour autant se laisser dompter, et un bon moment.
Peut-être en réponse à la grogne, Razor’s Edge tente de coller aux exigences de difficulté tout en rythmant encore un peu plus sa progression à coups de QTE qui, s’ils ne nous avaient pas manqué, font tout de même leur petit effet. Mais si la fluidité des séquences et des combats a eu l’air d’être le mot d’ordre de ce dernier épisode, on reste interloqué devant une structure des niveaux si primaire, enchaînant couloirs et arènes noyés sous les vagues d’ennemis. Une philosophie de la difficulté à côté de ses pompes, basée sur l’endurance le temps d’affrontements interminables. Et le retour de décisions sadiques, comme l’introduction d’un nouvel ennemi directement livré en quatre exemplaires, de quoi assurer un apprentissage « à la dure » complètement stupide.

Inégaux à l’origine, les trois jeux Ninja Gaiden ont en plus de ça vieilli plus ou moins fortement. Visuellement assez propre à défaut d’être de première fraicheur, la trilogie tourne à 60fps presque constamment, excepté lors de séquences où les explosions s’enchaînent. La remise en forme des vidéos, cracra comme tout dans Sigma, n’aurait pas été un mal, mais c’est tout un pan de la direction artistique qui reste, de toute manière, coincé il y a 15 ans. À commencer par le traitement des personnages féminins, totalement à l’Ouest et tout droit jusqu’à la beauferie. On ose espérer que l’épisode spin-off qu’aimerait monter Fumihiko Yasuda, le producteur de la série, et centré sur des héroïnes saura se montrer plus mature.
Ninja Gaiden Master Collection a été testé sur PS4 Pro via une clé fournie par l’éditeur. Il est également disponible sur PC, Xbox et Switch.
Si vous étiez venu pour une édition de maître, vous voilà bien attrapé, cette Master Collection se résumant à une refonte technique des versions revues de la trilogie commencée en 2004. Petit coup de surin supplémentaire dans le dos des fans, les seuls contenus supplémentaires sont fournis dans une édition Deluxe sous la forme d’un art book et des musiques du jeu. Pas de quoi sauter au plafond, d’autant que ces jeux ont moyennement bien résisté à l’épreuve du temps, sans se voir octroyer les ajustements mineurs qui auraient fluidifié l’expérience générale. Il reste intéressant de voir l’évolution d’une série qui reste les deux pieds ancrés dans son époque, manques et mauvais goût inclus, un épisode après l’autre. Que ça se fasse au prix fort et sans accompagnement éditorial, c’est autre chose.

Seastrom
C'est la Loire qui coule dans les veines de Seastrom, mélangée aux subtilités de la vaporwave. Possibilité de l'amadouer en lui parlant indés et D&D (Dreyer et Digimon).
follow me :

Articles similaires
Le Backlog de TPP : rongeurs, desperados et gatlings
avr. 03, 2025
Le Backlog de TPP : chaos, draugars et fondations
mars 06, 2025
À la compo' : Miki Higashino
mars 06, 2025